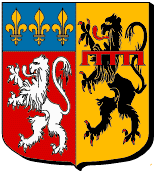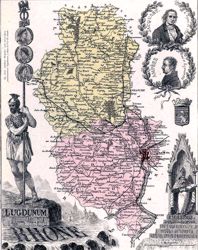Histoire du Rhône
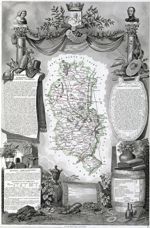
Le territoire qui forme le département
du Rhône avait été habité primitivement par les Ségusiens, peuple
gaulois de la clientèle des Éduens. Inférieurs, pour l'importance
politique aux Éduens, aux Arvernes et aux Séquanais, les Ségusiens
n'ont pas eu une histoire particulière ; ils se sont attachés
à la destinée du peuple qui étendait sur eux son vaste patronage
et ont eu le même sort. Le voisinage des colonies phéniciennes
et phocéennes de la Méditerranée et de la province romaine exerça
quelque influence sur leurs mœurs et leur caractère ; ils se
montrèrent mieux disposés que le reste des populations gauloises
à subir la domination de Rome.
On sait que, 124 ans avant
Jésus-Christ, le consul Domitius Ahenobarbus était intervenu,
par l'intermédiaire de Marseille, dans un démêlé survenu entre
la confédération des Éduens et celle des Arvernes unie aux Allobroges.
Biteuth, roi des Arvernes, fut vaincu dans une grande bataille.
C'est dans cette occasion qu'il fut donné aux Ségusiens de voir
pour la première fois les légions romaines. Les romains n’occupaient
qu'un seul établissement de quelque importance a Forum Segusianorum(Feurs),
César compta ce peuple au nombre de ses alliés lorsqu'il
soumit les Gaules ; une seule fois ils se-soulevèrent ; ce fut
en l'an 52, dans cette dernière grande campagne où toutes les
confédérations galliques, si longtemps divisées, se réunirent
autour de l'Arverne Vercingétorix. Mais le héros de l'indépendance
gauloise succomba, et les anciens alliés de Rome se firent aisément
à la domination nouvelle.

Ils n'eurent d'ailleurs pas à se plaindre
d'avoir à subir ce joug. Cette peuplade secondaire de la Gaule,
acquit tout d'un coup, par la fondation de la ville de Lyon,
la position la plus haute importance dans toute la Gaule.
Les Ségusiens furent compris par Auguste dans la province
Lyonnaise, puis dans la première Lyonnaise, par Dioclétien,
lors de la nouvelle division de l'empire en 292.
A la dissolution
de l'empire romain, ce pays fut l'un des premiers qui vit les
invasions barbares ; les Burgondes s'établirent au milieu d'eux
de 413 à 419. Le contact des barbares fut pénible à ce peuple
presque façonné à la politesse romaine, si l'on en croit le
portrait que le poète de Lyon, au Vème siècle, Sidoine
Apollinaire, trace des nouveaux venus « Que faire au milieu
de ces géants de sept pieds ? Est-il permis d'écrire rien d'élégant
au milieu de soldats dont la longue chevelure est imprégnée
de beurre aigre, et qui parlent une langue que nous ne comprenons
pas ? Peut-on chanter quand on a l'âme et le visage tristes
? Vos yeux sont bien heureux de ne pas voir des gens semblables,
et vos oreilles de ne pas les entendre Heureux, surtout votre
odorat de ne pas sentir ces hommes puants qui mangent par jour
dix bottes d'oignons ! Quelle muse se ferait comprendre au milieu
d'ivrognes criant toujours pour égayer leurs débauches ! De
tels dominateurs, comme vous le pensez, mettent de terribles
obstacles au désir qu'on aurait d'être joyeux. Mais je m'arrête
de peur qu'on ne prenne ceci pour une satire et qu'un ne me
dénonce aux Bourguignons. »

Les anciens Ségusiens n'étaient cependant
pas les plus mal partagés des peuples de la Gaule, et leurs
maîtres étaient réputés les plus doux entre les barbares ; Paul
Orose prétend qu'ils traitaient les Gaulois parmi lesquels ils
vivaient moins en sujets qu'en frères, et tout en faisant la
part de l'exagération de ce témoignage, nous avons la certitude
qu'ils se montrèrent moins durs envers les populations conquises
que les Wisigoths, et surtout que les Francs. Les Ségusiens
purent comparer les dominations burgonde et franque quand, en
534, à la suite des démêlés des fils de Clovis et de Gondemar,
fils et successeur de Gondebaud, ils eurent pour maître Childebert,
roi de Paris. A la mort de ce roi en 558, ils furent réunis
au reste de la monarchie franque par Clotaire et, après ce dernier,
ils passèrent à son fils Gontran (561).
Les maux de toute
nature fondirent à cette époque sur le pays. Ce furent d'abord
les fleuves qui débordèrent, puis une disette générale suivie
de la peste enfin une nouvelle invasion aussi terrible que les
précédentes, celle des Sarrasins, qui s'emparèrent de Notre-Dame-de-Fourvière,
capitale du pays et n'en furent chassés que par Charles-Martel
en 732. Au temps de Charlemagne, le Lyonnais respira sous la
bienfaisante administration du sage et savant. Leydrade, ami
du roi germain, qui lui-même, dit-on, eut un instant l'intention
de venir habiter, près de Lyon, le célèbre monastère de l'ile
Barbe.
Le Lyonnais échut à Lothaire, par suite du traité
de Verdun signé en 843. Cet empereur le laissa à son fils Charles,
qui le transmit à son second fils Lothaire II le Jeune puis,
un an après la mort de ce prince, la province lyonnaise et le
Beaujolais qui se trouve plus au nord, et qui jusque-là avait
suivi les mêmes vicissitudes, entrèrent, par le traité de Mersen
signé en 870, dans le partage de Charles le Chauve. Cette même
année, ces deux provinces, réunies au Forez, furent données
au comte Guillaume Ier, dont le fils, Guillaume II,
rendit la dignité de comte de Lyon héréditaire dans sa famille.
Guillaume II eut deux fils, Artaud et Bernard ; l'aîné, comte
de Forez, réunit à cette province le comté de Lyon ; Bernard
eut pour sa part le Beaujolais, qui, à partir de 920, eut une
existence distincte et une histoire particulière
A la faveur
des troubles que les incursions normandes, la déposition de
l'empereur Charles le Gros et l'établissement de la féodalité
amenèrent sur tout le sol gaulois, un seigneur, Rodolphe, fils
de Conrad, comte d'Auxerre, s'était fait proclamer, en 888,
roi de la Bourgogne transjurane. Son fils Rodolphe II avait
réuni la Provence à ses États. Le Lyonnais, situé dans une position
intermédiaire entre la France et ce royaume de Provence, devint
d'autant mieux un fief indépendant que les derniers Carlovingiens
et les nouveaux rois d'Arles s'en disputaient la mouvance.

En 955, Lothaire, fils de Louis d'Outre-Mer,
,mariant sa sœur Mathilde au roi d'Arles, Conrad le Pacifique,
lui donna en dot ses droits de suzeraineté sur le comté de Lyon.
Le comte était alors Artaud, qui gouverna de 920 à 960. Giraud
1er de 960 à 990, puis Artaud II, l'un des bienfaiteurs
de l'abbaye de Cluny de 990 à 1007, lui succédèrent.
Ce dernier
laissait deux fils en bas âge l'ainé, Artaud III, succéda à
son père dans le Lyonnais. Le gouvernement d'Artaud III fut
plein de vicissitudes. Lyon avait pour archevêque un membre
de la famille suzeraine des rois d'Arles, Burchard, fils de
Conrad le Pacifique et frère de Rodolphe III, dernier prince
qui régna. Ce Burchard regarda le comté de Lyon comme son apanage
et en fit hommage à l'empereur allemand Conrad le Salique, le
même qui, à la mort de Rodolphe III, hérita de la Bourgogne
transjurane et du royaume d'Arles. Chassé du Lyonnais, son héritage,
Artaud 1II, y rentra les armes à la main avec l'appui de son
frère et peut-être aussi à la sollicitation secrète des Capétiens
de France, qui pouvaient ne pas voir avec plaisir la suzeraineté
du Lyonnais passer à l'empire. Burchard fut à son tour chassé,
puis il revint par la toute-puissante protection de sa famille,
et un accord fut conclu entre le comte et l'archevêque. Le comte
abandonna grand nombre de ses droits seigneuriaux sur sa riche
capitale, Lyon, et reçut, en échange, des terres que l'archevêque
possédait dans le Forez. Artaud survécut peu à cet arrangement
; sa mort, son frère Giraud joignit le titre de comte du Lyonnais
à ceux de comtes de Roannais et de Forez qu'il possédait déjà
mais ce titre fut plus nominal que réel.
L'archevêque Burchard
mourut en 1031 et eut pour successeur son neveu Burchard, qui
considérait le titre de son oncle comme un droit héréditaire.
Giraud prit les armes, expulsa le nouvel archevêque et voulut
le remplacer par un de ses fils ; mais Burchard recourut à l'empereur
allemand Conrad, auquel il avait renouvelé l'hommage et le serment
déjà prêté par son oncle. Conrad envoya une armée, chassa Giraud
et son fils, rétablit Burchard et lui donna toute autorité.
C'est ainsi que la ville de Lyon échangea la domination immédiate
de ses comtes contre celle de ses archevêques ; Giraud ne reparut
plus dans la ville, et son fils, Artaud IV, tout en prenant
le titre de comte du Lyonnais de 1058-1076), fit du Forez, qu'il
possédait également, le lieu habituel de son séjour.

Rien n'égale la barbarie et la brutalité
de cette époque; la misère était générale parmi les populations
du Lyonnais; les dissensions des seigneurs, loin de profiter
à leur repos, redoublaient la tyrannie et les exactions que
chacun se croyait en droit d'exercer. La plus haute classe de
celle société féodale n'échappait pas à la sauvage férocité
des mœurs germaines que la religion était insuffisante à contenir,
et que ne tempérait pas encore la politesse de la chevalerie
et de ses institutions.
Entre autres enfants, Giraud II,
père d'Artaud IV, avait eu deux filles ; l'une d'elles, Botulfe,
épousa Guigues de L'Arieu, l'un des principaux seigneurs du
Forez. L'autre, Prève, bien que d'une éclatante beauté et recherchée
par de fiers barons, fut touchée de la grâce et ne voulut avoir
que le Seigneur pour époux, dit la légende. Ses jours s'écoulaient
dans un monastère au milieu des prières et d'un pieux recueillement,
quand un des chevaliers qui avaient brigué sa main s'en vint
la trouver et s'efforça de l'arracher à sa retraite ; vainement
Prève lui rappela qu'elle avait consacré à Dieu sa virginité
et que tenter de la détourner de ses devoirs était une entreprise
sacrilège ; ni larmes ni touchantes raisons ne purent convaincre
celui qui l'obsédait. Alors, la fille du comte lyonnais s'enferma
dans une noble fierté et chassa de sa présence un homme qui
ne craignait pas d'outrager Dieu ct l'une de ses servantes jusque
dans son sanctuaire. Le chevalier, plein de courroux, partit
méditant une terrible vengeance il vint à la cour de Giraud
et alla trouver ses trois fils Artaud, Geoffroy-Guillaume et
Conrad. « Savez-vous, leur dit-il, pourquoi votre sœur Prève
a rejeté avec mépris les plus braves de vos amis et tous les
seigneurs des deux comtés ? C'était pour se retirer, sous prétexte
de religion, dans un lieu reculé et y vivre en débauche avec
serfs et vilains. » Les jeunes gens le crurent ; ils prirent
leurs armes, montèrent vite leurs chevaux et coururent au monastère.
Prève était en prière ; mais, sans vouloir rien voir et rien
entendre « La voilà donc s'écrièrent-ils, celle qui déshonore
le comte et les fils du comte ! Et ils lui plongèrent une épée
dans les reins, puis ils coupèrent sa tête et jetèrent le cadavre
dans un puits ensuite ils revinrent contents d'avoir vengé leur
honneur. Mais voilà que la stérilité frappa toute la contrée
et que des signes de feu annonçaient dans le ciel le courroux
céleste ; si on cherchait de l'eau dans le puits où avait été
jeté le corps de l'innocente, on n'en tirait que du sang, et,
à l'endroit où avait roulé sa tête, sur une dalle de pierre,
avait fleuri un lis d'une éclatante blancheur ; en même temps,
une voix du ciel ne cessait de répéter aux fils de Giraud «
Votre sœur n'était pas coupable. » Convaincus par ces manifestations
de la volonté divine, ils s'en retournèrent au couvent, donnèrent
la sépulture au corps de la jeune fille, lui consacrèrent une
fondation pieuse, et depuis ce temps Prève compte, dans le martyrologe,
au nombre des vierges saintes.

A Burchard succéda, dans l'évêché de
Lyon, Humbert, et c'est par suite de l'arrangement convenu entre
lui et Artaud IV que ce dernier quitta Lyon.
Les successeurs
d'Artaud IV ne furent guère comtes du Lyonnais que nominalement
; Wedelin, 1016 ; Artaud V, 1078 ; Guillaume III 1085 ; Ide
Raimonde et son époux Guigues ou Guy de Viennois, 1097 ; Guigues
II, 1109 ne résidèrent pas dans le pays. Mais Guigues III, qui
remplaça dans le titre de comte son père Guigues II en 1137,
et qui, après avoir atteint, sous la tutelle du roi de France,
Louis VII le Jeune, l'âge de majorité, fit une guerre heureuse
à Guillaume II, comte de Nevers, prétendit revenir sur les anciennes
conventions passées entre son aïeul Artaud IV et l'archevêque
Humbert. C'était, dit un historien de la vie de saint Bernard
une grande injustice envers l'Église ; dans la guerre que Guigues
avait soutenue contre le comte de Nevers, bien inférieur en
force à son adversaire, il aurait été infailliblement battu
sans les prières du saint et la protection manifeste que Dieu
accorda à son intercession. Quoi qu'il en soit, Guigues ne se
montra pas reconnaissant. Héraclius de Montboissier, archevêque
de Lyon, avait obtenu, en 1157, de l'empereur Frédéric Ier,
par une bulle d'or, datée d'Arbois le 19 novembre, l'exarchat
du royaume de Bourgogne, avec tous les droits régaliens sur
la ville de Lyon. Guigues, qui voulait conserver au moins sa
prépondérance, sinon gouverner seul, dans cette capitale de
l'un de ses comtés et ne reconnaitre d'autre suzeraineté que
celle de Louis VII, s'offensa de cette concession et entra dans
Lyon à main armée ; les partisans du prélat furent maltraités
; les clercs surtout furent malmenés grandement on pilla leurs
maisons, et l'archevêque fut obligé de sortir de la ville où
il ne rentra que l'année suivante, exerçant un pouvoir précaire
jusqu'à sa mort survenue en 1163, sans cesser un instant d'être
molesté par son terrible adversaire.

L'empereur Frédéric, qui n'avait aucunement
abandonné ses droits de suzeraineté sur sa capitale du Lyonnais,
malgré la prétention de Guigues à se reconnaitre vassal de Louis
VII voulut l'année suivante élever une forteresse sur le territoire
de Lyon. Le comte chassa les ouvriers et les menaça, s'ils revenaient,
de les faire tous pendre. En même temps, il entretenait les
dissensions qui, à la mort d'Héraclius, s'étaient élevées dans
le chapitre, pour le choix de son successeur, et s'installa
dans la ville mais il en fut chassé par Drogon, l'un des deux
candidats à l'archevêché, qui, après l'avoir emporté sur son
rival Guichard, recourut au comte de Mâcon, arma ses partisans
et chassa le comte.
Guigues recourut alors à son protecteur
naturel, Louis VII, qui faisait en Auvergne la guerre au comte
Guillaume. « Seigneur, lui écrivit-il, je m'étonne qu'étant
votre homme à tant de titres, qu'ayant été fait chevalier par
Votre Majesté, laissé par mon père sous votre garde, et d'ailleurs
votre vassal, je n'aie rien appris de votre arrivée en Auvergne
; cependant je serais dans votre armée sans le comte de Mâcon,
Girard, et les schismatiques de Lyon qui sont entrés à main
armée sur ma terre ; ils sont venus non seulement pour me dépouiller
s'ils le pouvaient, mais encore pour transporter mon comté,
qui relève de votre couronne, à l'empire teutonique. S'ils y
réussissaient, ce serait un outrage sanglant qu'ils vous feraient
en face et au mépris des armes que vous avez entre les mains.
Que Votre Majesté prenne donc les mesures convenables pour mettre
son honneur à couvert et mes domaines en sûreté. » Louis écouta
favorablement son baron il alla le trouver dans la capitale
du Forez, et, en retour de la bonne réception que lui fit le
comte, il lui accorda, sur sa demande, l'investiture de l'abbaye
de Savigny. Mais ce fut dans le pays une source de querelles
; Humbert III, sire de Beaujeu, protecteur et patron, en vertu
de ses droits héréditaires, de l'abbaye de Savigny, s'opposa
à cette concession et força Guigues d'y renoncer solennellement
en présence même de Louis et de sa cour. Le roi, pour dédommager
son serviteur, lui donna la garde des grands chemins, dans l'étendue
des deux comtés du Forez et du Lyonnais.

Cette concession est d'une haute importance
dans l'histoire générale de la France ; elle nous apprend, en
effet, qu'à une époque qui précède le règne de Philippe-Auguste,
et où la féodalité était encore toute puissante, le roi conservait
la garde des grands chemins dans toute l'étendue du royaume,
et que les seigneurs particuliers ne la tenaient dans leurs
domaines qu'en fief et de la munificence royale. C'est que ce
droit était l'un des plus importants et de ceux que la royauté
n'a perdus que localement et qu'elle s'est efforcée le plus
tôt de reconquérir ; il donnait la connaissance et justice des
crimes commis sur les grands chemins.
L'archevêque Drogon
fut chassé par Guichard; mais la contestation pour la prééminence
dans Lyon continua entre Guigues et le nouveau prélat. Il y
eut un premier accord en 1167, à la suite duquel la querelle
s'envenima de nouveau et ne s'apaisa qu'en 1173 par la cession
absolue que le comte fit de ses droits en échange d'une somme
d'argent et de terres dans le Forez. Cet accord fut approuvé
par les papes Alexandre III et Lucius III et ratifié par Philippe-Auguste,
en 1183, qui reçut de Jean aux belles mains, alors archevêque,
hommage pour la partie de la ville située sur la rive droite
de la Saône, tandis que l'empereur Frédéric se faisait prêter
serment pour le territoire de la rive gauche. C'est ainsi que
fut consacrée cette distinction qui, de nos jours, s'est maintenue
par la tradition et subsiste encore parmi les bateliers du fleuve
dans leurs dénominations de France et Empire appliquées en opposition
à l'une et l'autre rive.
Au milieu de la guerre dont Lyon
fut le théâtre entre les habitants et les archevêques, les rois
de France commencèrent à intervenir et jeter les fondements
de leur domination prochaine. Lyon était alors, et elle est
à peu près restée depuis, tout le Lyonnais ; Guigues, qui abdiqua
la dignité en 1199, et ses successeurs se bornèrent à la possession
du Forez ; ils retenaient bien quelques restes de leur ancienne
suprématie sur le comté de Lyon mais ces droits se bornaient
à peu de chose et s'amoindrissaient chaque jour. C'est ainsi
que Guigues V reconnut par une charte, en 1224, que plusieurs
lieux, Saint-Rambert, Bonson, Chambles, Saint- Cyprien et Saint-Just,
où ses successeurs et lui avaient le droit de taille à volonté,
étaient francs alleux de l'abbaye de Sainte Barbe Il s'en désista
et accorda aux habitants le pouvoir de donner, vendre, obliger,
aliéner leurs fonds sans retenir pour lui autre chose que ses
droits saufs et sa pleine seigneurie sur les biens que ces mêmes
habitants auraient dans d'autres paroisses. Quant à la capitale,
elle continua d'être agitée par les discordes des habitants
et de leur prélat. Une constitution du pape Grégoire X, en 1273,
ne mit pas un terme aux animosités ; les Lyonnais, à l'occasion
d'une rivalité qui s'était glissée dans l'église entre l'archevêque
et les chanoines, au sujet de l'exercice de la justice, recoururent
au roi de France et lui demandèrent protection. Philippe le
Bel, qui régnait alors, saisit avec joie ce prétexte d'intervention
; il établit, en 1292, un gardiateur de la ville, magistrat
chargé de recevoir et de juger au nom du roi les appels des
bourgeois.

Six ans plus tard, le roi de France agrandit
ses prétentions ; il exigea de l'archevêque qui venait d'être
nommé l'hommage illimité et le serment de fidélité tel que le
prêtaient les autres prélats du royaume. Henri de Villers, archevêque,
réclama auprès de l'ennemi de Philippe le Bel, Boniface VIII,
contre cette autorité et ces prétentions qui lui semblaient
exagérées. Boniface avait fait droit aux réclamations de l'archevêque
; il y eut conflit entre ses officiers et ceux du roi. Philippe,
qui ne souffrait ni atteinte à ses volontés ni contestation
de ses droits réels, s'arrogea, par deux édits datés de Pontoise
(1307), l'exercice de la double jurisprudence archiépiscopale
et royale. Il y était dit que le roi, dans toute la ville et
cité de Lyon, et dans toute la baronnie de l'église de Lyon,
en deçà de la Saône, connaitrait des appellations et des sentences
définitives données par le juge lay (laïque), et que ces appellations
seraient jugées au parlement par plusieurs conseillers royaux,
suivant le droit écrit, et que l'archevêque ferait au roi serment
de fidélité, sans toutefois que les biens de son église fussent
censés être du fief du roi.
Henri de Villers se soumit mais
son successeur, Pierre de Savoie, qui monta sur le siège archiépiscopal
en 1308, débuta par réclamer contre les deux édits et s'apprêta
à soutenir ses réclamations par les armes. Louis le Hutin, fils
ainé de Philippe, fut envoyé contre lui en 1310, et fit le siège
de cette ville. Pierre, pressé par les ennemis, fut obligé de
se rendre ; conduit à Paris, il demanda pardon au roi, qui lui
fit grâce, et termina le différend en 1313 par la cession absolue
de tous les droits de l'église sur la ville, en échange de quelques
terres ; le château de Pierre-Scise demeura seul sous la juridiction
ecclésiastique.
C'est ainsi que le Lyonnais et sa ville,
après avoir subi sous ses comtes, puis ses archevêques, la domination
des rois de Bourgogne transjurane et de Provence, et ensuite
de l'Empire depuis le temps où Lothaire l'avait donné à sa sœur
Mathilde, rentra sous la domination des rois de France, non
plus comme un fief lointain et de mouvance incertaine, mais
comme partie intégrante de la France royale.
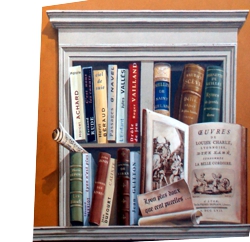
Une condition expresse de l'acte de réunion était que jamais un roi ne pourrait aliéner cette province et la donner en apanage. Le Beaujolais Bellojocensis ager, borné au nord par le Charolais et la Mâconnais, au sud par le Lyonnais et le Forez, à l'est par la Saône et à l'ouest par le Forez, a commencé à jouir d'une existence distincte à partir 920, avec Bérard ou Bernard, fils puiné de Guillaume, comte de Lyonnais et de Forez. Son histoire et celle de la seigneurie ne sont pas connues jusqu'à Guichard, successeur d'un Béraud II, qui mourut vers 967. Ce fut pendant longtemps une race pieuse que celle des sires de Beaujolais ; Guichard Ier fit à l'abbaye de Cluny de nombreuses donations; son fils, Guichard II, possédé du désir de visiter les Lieux saints, accorda, avant son départ, à l'église de Mâcon, réparation de quelques exactions et concéda à son évêque de grands privilèges ; Humbert Ier; ne fut pas moins libéral, et voici en quels termes son fils Guichard III, qui lui succéda, rapporte dans la charte de fondation les motifs qui l'engagèrent à élever, en 1115, le prieuré du Joug-Dieu qui, en 1137, fut érigé en abbaye, et a été sécularisé à la fin du VIIème siècle, par sa réunion à la collégiale de Villefranche. « Une nuit, dit la charte accordée en fan 1118, étant seul dans ma demeure de Thamais, j'eus la vision suivante : six hommes vénérables, tout resplendissants de lumière, m'apparurent ayant des jougs à leur cou et tirant une charrue sur laquelle était appuyé le saint homme Bernard, abbé de Tyron, un aiguillon à la main, dont il les piquait pour leur faire tracer un sillon droit. À mesure qu'ils avançaient, je voyais sortir des fruits en abondance. Après avoir longtemps songé à cette vision, j'allai trouver l'abbé Bernard à qui j'offris ce même lieu de Thamais, avec ses dépendances pour y mettre des hommes qui sous le joug du Seigneur, prieront continuellement pour moi et les miens ; ce qu'il m'accorda volontiers, et, pour conserver la mémoire de la vision dont je viens de parler, je veux que ce monastère s'appelle le Joug-Dieu. » En 1129, le même Guichard eut l'honneur de recevoir dans son château de Beaujeu le pape Innocent II, lorsque l'antipape Anaclet se fut rendu maitre de Rome ; puis, mettant le comble à sa piété, il prit l'habit de religieux à Cluny, où il mourut en 1137. Son fils Humbert II ne suivit d'abord pas la même voie de salut que ses prédécesseurs sa conduite fut d'une extrême licence ; mais bientôt touché de repentir, il passa en terre sainte et entra dans l'ordre des Templiers.

Sa femme Alix, fille du comte de Savoie,
sans le consentement de laquelle il avait pris ce parti, obtint
du pape Eugène III, par le crédit de l'archevêque de Lyon et
de l'abbé de Cluny, qu'il fût rendu à la vie séculière, sous
la seule condition de faire une fondation pieuse. Humbert revint
alors de terre sainte et son retour fut un grand triomphe pour
le clergé. « Les brigands, dit à ce sujet Pierre le Vénérable,
abbé de Cluny, les pillards des biens de l'Église, des veuves
et de tout le pauvre peuple qui était sans défense, tremblèrent
en le voyant reparaitre. Il ne trompa l'attente ni des uns ni
des autres. Il atterra tellement le vicomte de Mâcon, ce loup
qui, le matin, le soir et la nuit ravageait nos terres, qu'il
lui fut permis de dire avec Job : « Je brisais les mâchoires
du méchant et j'arracherais la proie de ses dents. » Humbert
n'avait pas perdu, en se convertissant, ses habitudes guerrières
et son caractère ambitieux; il porta ses armes chez les seigneurs
voisins et se fit céder par Renaud Ill, sire de Beaugé de Bresse
et d'une partie de Dombes, quelques châteaux et ce dernier pays.
Nous avons vu comment Humbert sut empêcher les effets de la
concession surprise par le comte de Lyonnais et de Forez au
roi Louis VII, pour l'abbaye de Savigny. Sur la fin de ses jours,
ce puissant baron se retira à Cluny, où il mourut en 1174. Humbert
Ill, son successeur, n'eut pas la piété de ses aïeux ; il continua
la guerre contre le seigneur de Bresse et ne craignit pas de
porter aussi ses armes sur les terres de cette abbaye de Cluny,
où son père était mort et où reposaient ses cendres. Mais il
fut le fondateur de Villefranche qui depuis est devenue la capitale
du Beaujolais et joignit à ses domaines la seigneurie de Montpensier.
Guichard IV, fils de Humbert II, épousa la sœur de Philippe-Auguste
et prit part à la croisade contre les Albigeois, avec Louis
de France, plus tard Louis VIII. Ce sire de Beaujolais joua
un rôle important dans la politique du temps ; il alla comme
ambassadeur du roi de France trouver le pape Innocent III et
l'empereur de Constantinople, qui le renvoya chargé de riches
présents. A son retour par Assise, il obtint de saint François
trois religieux de son ordre qu'il amena à Villefranche, où
il fonda pour eux le premier couvent que cet ordre ait eu en
France. Sur les murs du cloitre, encore subsistant à la fin
du XIIIèmesiècle, on lisait : « Guichard de Beaujeu,
revenant ambassadeur de Constantinople, ramena trois compagnons
de saint François d'Assise, fonda leur couvent de Pouillé le-Châtel,
l’an 1210, où ils demeurèrent six ans ; de là, furent amenés
et fondés en ce lieu, par le même Guichard, l'an 1216. »
Entièrement dévoué à la maison de France, Guichard retourna
avec Louis, en 1215, dans le Languedoc, puis l'accompagna dans
son expédition d'Angleterre, où il mourut à Douvres en 1216.

Son fils, Humbert IV, continua les relations
d'amitié qui unissaient sa famille à la maison de France; il
fut nommé gouverneur du Languedoc par Louis VIII, et ce titre
lui fut confirmé par Louis IX en 1227. Humbert prit part à toute
la guerre désastreuse du Midi, et nous le reverrons dans ces
départements malheureux qu'a ravagés la guerre des Albigeois.
Baudouin II, empereur latin de Constantinople, ayant fait un
voyage en Europe, en 1239, pour chercher du secours, fut reconduit
dans ses États par Humbert. La dignité de connétable, que son
cousin, le roi de France, saint Louis, lui accorda à son retour
l'année suivante, fut la récompense de tous les services qu'il
avait rendus à la maison royale.
En 1248, le sire de Beaujeu
suivit le roi dans son expédition en Égypte, et il y trouva
la mort en 1250. Après lui, Guichard V gouverna jusqu'en 1265
et, dit une vieille chronique, .« fut fort plaint et regretté
de toutes manières de gens quand il trespassa, car ce fut en
son tems ung sage prince et de bonne conduite par quoy ce fut
une moult grant perte tant pour le royaume que pour son pays
et ses parens. »
Humbert mourut sans postérité mâle; sa
fille, Isabelle, lui succéda, non sans contestation de la part
de ses neveux, et transmit la seigneurie à son second fils Louis
de Forez, qu'elle avait eu de son mariage avec Renaud, comte
de Forez. Louis eut quelques démêlés avec les seigneurs voisins
et les archevêques de Lyon, et mourut en 1290 ou 1294. Son successeur,
Guichard VI, gouverna jusqu'en 1331 et mérita d'être surnommé
le Grand ses guerres furent nombreuses ; il prit part, entre
autres, à celle de Flandre, avec Philippe de Valois, et commanda
un corps d'armée à la bataille de Cassel, en 1228. Il mourut
dans cette guerre, et son corps fut rapporté dans sa seigneurie
et inhumé dans un tombeau qu'il avait fait faire exprès, dès
sa jeunesse, à l'église de Belleville.
Son épitaphe est curieuse;
nous la donnons comme un spécimen du latin de cette époque :
Ter et milleno primo ter quoque deno,
Princeps Guichardus,
leo corde, gigas, leopardus,
Audax bellator et nobilitatis
amator,
Nunquam devictus bello, pro militia ictus,
Vincitur
a morte : cœli pateant sibi portæ
L’An mille trois
cent et aussi trois fois dix plus un, le seigneur Guichard,
lion par le cœur, géant, léopard, audacieux guerrier et ami
de la noblesse, jamais vaincu à la guerre, frappé dans les combats,
est vaincu par la mort; que les portes du ciel s’ouvrent at
à lui !
Il avait été grand chambellan et seigneur gouverneur
des rois Philippe le Bel, Louis le Hutin, Philippe le Long,
Charles le Bel et Philippe de Valois.
Son fils, Édouard
Ier(1331-1351), « estoit fort dévot à la vierge Marie;
il mena quantité de gentilshommes au voyage d'oultre-mer à ses
propres couts et dépens et batailla longtemps contre ceux qui
tenoient la loi de Alahomet. » Il fit aussi la guerre aux Anglais
et périt dans un combat près d'Ardres, fidèle à 1'alliance de
sa famille avec la maison de France. Antoine, son fils, se distingua
à la bataille de Cocherel (1364), puis s'attacha à la fortune
de Bertrand Du Guesclin et mourut en 1374, à Montpellier.
Antoine ne laissait pas d'enfants; ce fut Édouard II, petit-fils
de Guichard VI, qui lui succéda. De ce seigneur datent les privilèges
et immunités accordés à Villefranche.
Édouard eut à soutenir contre Marguerite,
sœur du dernier baron de Beaujeu, une guerre pour la succession
à la seigneurie ; il y eut accommodement, puis rupture, et enfin
un traité définitif, en 1383, après des combats désavantageux
pour Édouard et quelques conquêtes d'Amédée le Rouge, fils de
Marguerite et du comte de Savoie, dans ses domaines. Le fait
capital du gouvernement d'Édouard fut sa double querelle avec
le roi de France Charles VI, qui montre quelle extension avait
prise l'autorité de nos rois et comment leur justice s'exerçait
dans les seigneuries féodales. Édouard, était d'un caractère
avide et hautain ; il avait saisi le douaire de Batrix, femme
de son prédécesseur ; celle-ci en appela au roi de cette violence.
Un jugement fut rendu contre Édouard au parlement de Paris ;
mais quand les huissiers royaux vinrent lui signifier l'arrêt,
il les maltraita et les fit chasser. Un arrêt de corps fut signifié
contre sa personne ; le comte se défendit contre les commissaires,
sergents et archers du Châtelet envoyés pour l'exécution du
jugement. Mais enfin il fut pris et amené au Châtelet, détenu
prisonnier, puis relâché seulement à l'intercession du comte
de Savoie, et Charles VI signifia par les lettres de rémission
'« qu 'il souffrira lever dans sa seigneurie de Beaujeu les
aides que Sa Majesté a imposés, comme aussi les arrérages des
rentes échues; faute de quoy ladite grâce sera sans nul effet.
» Mais rentré dans ses domaines, le baron ne devint pas plus
circonspect et n'adoucit pas la rudesse de son caractère. Il
enleva une fille de Villefranche ; ajourné au parlement pour
ce méfait, il fit jeter par les fenêtres du château de Perreux
l'huissier qui vint lui faire la citation. Arrêté et conduit
en prison à Paris, il courait risque de perdre la tête et ne
fut sauvé que par le crédit du duc de Bourbon et moyennant la
cession qu'il fit à ce prince du Beaujolais, au cas où il mourrait
sans enfants légitimes. Le cas se réalisa quelque temps après,
en 1400, et la baronnie entra ainsi dans les vastes États de
la maison de Bourbon. Un héritier de cette famille, Pierre IV,
fils de Charles de Bourbon, obtint. en 1475, de son frère aîné,
héritier du duché, la baronnie de Beaujeu, et ce fut lui qui
épousa la célèbre princesse Anne, fille de Louis XI, qui, pendant
la minorité de son frère Charles VIII, poursuivit contre les
derniers seigneurs la politique de son père, avec presque autant
d'habileté que lui. En 1488, les revenus du Beaujolais, sinon
le titre de seigneur, passèrent au cardinal Charles de Bourbon,
en échange de ses droits sur le Bourbonnais dont Anne se saisit
au nom de son époux; puis, par une fille de Pierre de Beaujeu
et d'Anne de France, Suzanne, le Beaujolais passa à Charles
III, comte de Montpensier, dauphin d'Auvergne et ce fameux duc
de Bourbon qui, chassé de France par la spoliation de Louise
de Savoie, mère de François er, porta les armes contre
sa patrie. Le Beaujolais réuni à cette époque fut, en 1560,
donné par François II à Louis le Bon, duc de Montpensier, et
par succession parvint à Marie de Bourbon, épouse de Gaston
d'Orléans, frère de Louis XIII, et passa, du chef de cette princesse,
à sa fille Anne-Marie- Louise d'Orléans, la fameuse Mademoiselle,
née en 1627 et morte sans alliance publique en 1683. Le Beaujolais
fit alors partie jusqu'en 1789 des possessions de la seconde
famille d'Orléans. On appelait Franc-Lyonnais une petite contrée
d'environ deux lieues et demie de longueur sur une de largeur,
s'étendant sur la rive gauche de la Saône ; elle contenait 13
paroisses exemptes de taille, d'où le nom qu'elle portait. Elle
jouissait, disait-on, de ce privilège sous les rois de Bourgogne
et les empereurs et ne s'était donnée à la France qu'à la condition
qu'il serait maintenu. Ce fut Louis XI qui, en l477, la réunit
à la couronne.
Le Lyonnais, le Beaujolais, le Forez et le
Franc-Lyonnais furent réunis en un grand gouvernement qui a
subsisté jusqu'en 1790. Outre le gouverneur général, il y out
un lieutenant du roi et un grand bailli d'épée pour le Beaujolais
et un sénéchal pour le Lyonnais. Toute la généralité ressortissait
au parlement, à la cour des aides et à la chambre des comptes
de Paris. Le présidial de Lyon date de 1552. En 1790, lors de
la répartition de la France en départements, on forma le vaste
département de Rhône-et-Loire, qui, après le siège de Lyon par
la Convention, fut scindé en deux, celui de la Loire, avec Montbrison
pour chef-lieu, et celui du Rhône, qui conserva pour capitale
Lyon, un instant appelé Commune -Affranchie en 1793. On a pu
suivre, dans le récit rapide que nous venons de faire, l'effacement
graduel des influences provinciales jusqu'à leur absorption
dans la grande unité française, résultat de la nouvelle division
territoriale en 1790. À dater de cette époque surtout, l'histoire
de Lyon sera l'histoire du Lyonnais et du département du Rhône
tout entier. L'unité des lois, la facilité des communications
rendront chaque jour l'assimilation des populations plus absolue
et plus complète. Signalons toutefois, avant qu'ils disparaissent
pour toujours, les derniers vestiges d'une originalité primitive
que la diversité des travaux et la différentie de climat disputent
encore au niveau envahisseur de l'industrialisme moderne. Les
fleuves, ces premiers chemins ouverts par la nature au génie
du commerce, ont presque toujours déterminé l'établissement
des grandes capitales ; c'est par ses deux fleuves que Lyon
a grandi, c'est aussi sur leurs rives qu'elle étend de jour
en jour son influence et ses conquêtes. Depuis Neuville, où
la rive gauche de la Saône commence à appartenir au département
du Rhône, jusqu'à Givors, où le fleuve va le quitter pour l'Isère
et l'Ardèche, tout appartient à l'industrie. Sur toute cette
étendue, dans un parcours de 60 kilomètres, le département n'est
qu'un vaste entrepôt, un immense atelier; chantiers pour l'extraction
et la taille des pierres, décreusage et teinture de la soie,
impressions sur étoffes, charronnages et forges pour constructions,
verreries, amas gigantesques de charbons, montagnes de caisses
et de ballots; toutes ces richesses n'ont qu'un maître, Lyon
; tous ces bruits ne sont que des échos de la grande ville;
toute cette activité n'est qu'un rayonnement du foyer commun.
Lyon
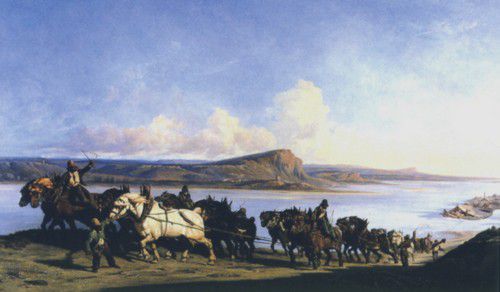
Le parc de la Tête d'Or
Lugdunum est fondée en 43 avant JC, par
le proconsul Munatius Plancus, « à l'endroit où la Saône et
le Rhône mêlent leurs eaux » pour établir les familles romaines
chassées de Vienne par le soulèvement des Allobroges à la mort
de César. Située au confluent de la Saône et du Rhône, à proximité
de la vallée de la Loire par le passage de Tarare et au débouché
des routes des Alpes, Lugdunium devient rapidement une ville
importante. On peut distinguer, à l'époque romaine, la ville
situé sur la rive droite de la Saône, avec le forum, un théâtre,
un amphithéâtre, des bains et autres constructions. La ville
gauloise, Condate, est quant à elle située sur la colline de
la Croix Rousse et sur la bande de terre séparant les deux cours
d'eau. La ville basse est le centre du commerce fluviale est
le centre religieux de tous les peuples de la Gaule.
En 12 avant JC un autel en faveur de
César Auguste y est érigé. et chaque année les députés des soixante
cités de la Gaule s'y réunissent. Sous Néron, en 65 un incendie
détruit une grande partie de la ville. Celle ci est évangélisée
dès 170, vraisemblablement par des levantins, C'est en 177 que
Blandine et ses compagnons d'infortune connurent le martyr.
Au IVème, elle est la métropole de la Lyonnaise Ière.
Occupée par les Burgondes au milieu du Vème, elle
devient la capitale de la Burgondie. Elle passe ensuite sous
la domination des Francs au début du Vi.. Sous le règne des
rois Carolingiens, la cité est le centre du Pagus Luguensis
qui va des monts du Forez au Jura. Les partages carolingiens
l'attribuent à l'Empire. Au Xème elle Lugdunum doit
faire face aux invasions des Hongrois. Le XIIème
est marqué par la lutte pour l'autorité entre le comte du Forez,
suzerain de la banlieue de Lyon et l'archevêque à qui Frédéric
Barberousse a cédé, par la bulle d'Or en1157, tous ses droits
régaliens. Cette lutte se termine en 1173 et le comte du Forez
abandonne tous se droits sur la ville.L'archevêque, prima des
Gaules , réside au château de Pierre Scize, sur un rocher qui
domine la Saône et commande la ville, il a dans e lyonnais droit
de justice, de battre monnaie et de lever des impôts.. Mais
il partage le pouvoir avec le chapitre de Saint Jean, composé
de trente deux chanoines qui portent le titre de comte. Les
Lyonnais conquièrent leurs premières libertés au XIIIème
siècle, à la suite d'un conflit avec l'archevêque pour la garde
des clefs, les bourgeois obtiennent le droit de les conserver.
A la suite d'ingérence du roi de France, Louis IX (Saint Louis)
dans la ville, l'archevêque prête hommage à celui-ci en 1229.Par
les Philipines, le roi et reconnu comme « gardiateur de la ville».
A la suite du refus de l'archevêque Pierre de Savoie de prêter
hommage au roi, les troupe royale viennent occuper Lyon et le
12 avril 1312, Pierre de Savoie signe l'acte de réunion du lyonnais
à la couronne de France.
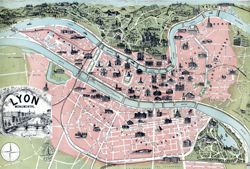
Les bourgeois obtiennent en 1320 la création
d'une commune; ils ont le droit de s'assembler, d'élire des
magistrat, de faire la guerre et de lever des impôts. au XiVème
siècle la vile de Lyon es très prospère. Pendant la Guerre de
Cent Ans la ville est attaquée par les «Tard Venus» Pour se
prémunir contre les attaques Lyon s'entoure, d'un système de
fortifications englobant les quartiers de la rive droite de
la Saône. Au XVème et surtout au XVIème
siècle Lyon prend une grande importance économique avec les
foires. C'est la deuxième ville du royaume. Le premier livre
est imprimé à Lyon en 1473 et en 154, on dénombre 413 imprimeurs
installés dans la cité lyonnaise.
C'est un des foyer de
la Renaissance : Rabelais, Etienne Dolet, Antoine du BaÏf y
séjournent. ainsi que Louise Labbé, Maurice Scève, Philibert
Delorme. l'industrie textile commence à se développer. le comte
du Forez abandonne tous se droits sur la ville.

Mais le peuple est misérable, il se révolte
en 1529. ( la grande Rebeyne) Les débuts du protestantisme sont
favorisé par la présence des imprimeurs et des humanistes. La
Saint Barthélémy provoque une réaction catholique; pendant la
Ligue, un véritable gouvernement local se constitue, qui confisque
les biens des protestants. Henri IV entre dans la ville en 1595.
Au XVIIème et au XVIII, la vie économique est intense,
la « fabrique » est réglementée par Colbert en 1667. La ville
s'étend, sont ainsi crées les faubourgs de la Guillotière, de
la Croix Rousse se développent, Perrache, constitue une société
pour reculer le confluent, on aménage la place Bellecours. Napoléon
fait de Lyon un grand centre industriel; en 1810 13295 métiers
occupent 22 538 personnes. Entre 1815 et 1825, le nombre de
métiers passe de 20 000 à 27 000. Les canut se révolte en 1834.
Le 24 juin 1894, un anarchiste italien du nom de Santo Caserio
poignarde le président de la République François Marie Sadi
Carnot rue de la Ré entre la place des Cordeliers et la place
de la Bourse.
Villefranche-sur-Saône
Ce n’est que vers le milieu du XIIème
siècle que le seigneur de Beaujeu Humbert III décide de créer
une ville à proximité d’un croisement entre une route Nord-Sud
d’origine romaine et une route Est-Ouest venant de Tarare ou
Thizy qui permettait de gagner un gué sur la Saône. Il voulait
aussi renforcer la frontière Sud de ses domaines face aux Archevêques
de Lyon qui détenaient le château d’Anse.
Cette ville nouvelle
s’installe sur les rives escarpées du Morgon et les habitants
s’appelleront les «Caladois», du nom du lieu-dit «Calade», pouvant
désigner les dalles de pierre situées au niveau actuel du parvis
de l’Eglise Notre-Dame des Marais.
Plusieurs historiens placent
le berceau de Villefranche dans le milieu du XIème
siècle, sous Humbert III, seigneur de Beaujeu. Celle ville,
qui ne dut son nom qu'aux franchises qu'elle obtint plus tard,
s'appelait dans L’origine Lunna. Elle ne s'étendait pas, comme
aujourd'hui, sur les deux penchants d'une colline légèrement
inclinée ; elle était tout entière placée sur le coteau méridional,
dans le lieu qu'on appelle la Porte-d'Anse.
Les seigneurs
de Beaujeu comprirent quelle importance s'attachait à la création
de cette ville, placée au milieu d'une fertile contrée, à égale
distance de deux grandes cités, Lyon et Mâcon, et assez près
de la Saône pour emprunter le secours de la navigation de cette
rivière. Jaloux de féconder tant de germes de prospérité, ils
accordèrent à la ville naissante des privilèges inouïs. L'enceinte
fut défendue par des remparts, le peuple secouru par des établissements
de charité, la bourgeoisie relevée par des immunités, le clergé
flatté par la pompe des édifices du culte et par le nombre des
maisons religieuses.
L'église paroissiale s'embellit en
même temps par les bienfaits de la piété publique ; le clocher
qui subsiste aujourd'hui n'est que le reste d'une tour construite
en 1518, et l'une des plus hautes et des plus admirables du
royaume. Cette église fut détruite dans un violent incendie
le 15 avril 1566.
La partie la plus curieuse de l'histoire
de Villefranche est celle qui traité des franchises et des privilèges
qui lui furent accordés par Humbert IV, fondateur de la ville,
lequel, pour attirer des habitants, autorisa les maris à battre
leurs femmes jusqu'à effusion de sang, pourvu que la mort ne
s'ensuivît pas.
Les environs de Villefranche offrent des
vues pittoresques , de nombreuses maisons de plaisance et des
châteaux remarquables.
Bien protégée par son enceinte partiellement
conservée, la ville se développe progressivement pendant l’époque
médiévale.
Située sur un des axes principaux du royaume,
Villefranche détrône au XVIème siècle Beaujeu trop
excentrée comme capitale du Beaujolais. De belles maisons sont
construites durant les XVIème , XVIème
et XVIIIème siècles. Elles sont occupées par des
hommes de loi, des auberges et de riches bourgeois. Mais elles
restent toujours conformes à la disposition traditionnelle dictée
par un parcellaire ancien à la fois étroit et allongé.
Ces
constructions sont reliées à chaque niveau par des galeries,
initialement en bois ensuite en pierre. La découverte de ces
cours de style gothique, renaissance, classique ou baroque constitue
une bonne initiation à l’histoire de l’art. Au XVIIème
siècle sont construits dans un style harmonieux et sobre l’ancien
Hôtel de Ville et l’Hôtel Dieu (actuellement la Maison du Tourisme).
Depuis 1790, la Sous-Préfecture est installée dans l'ancien
couvent des Cordeliers construit au XVIIIème siècle.
Villefranche va devenir au XIXème siècle une ville
industrielle particulièrement active dans le domaine de l’industrie
du textile. Elle saura surmonter la crise de celle-ci et prouver
son dynamisme économique au XXème siècle en diversifiant
ses activités.
Le Beaujolais
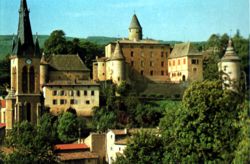
On ne saurait parler du Rhône, sans évoquer un grand terroir viticole de notre pays. Le Beaujolais qui étale ses vignobles depuis Macon, jusqu’aux portes de Lyon.
Guignol
Le personnage
incontournable de Lyon est sans conteste Guignol. Si tous les
lyonnais le connaissent, car ce personnage frondeur, espiègle,
satirique au possible et par-dessus tout amoureux de sa propre
liberté est sans aucun doute les personnages le plus apprécié
et fait la joie des « gones »
Son créateur, Laurent Mourguet
eu pourtant une vie qui ne fut pas particulièrement drôle. Né
en 1769, il a 20 ans lorsque qu’éclate la révolution de 1789.
Fils d’un maître ouvrier tisseur, il est l’ainé de sept enfants.
Il se marie en 1788 avec Jeanne Esterle, avec laquelle il aura
dix enfants et comme nombre de canut, ils vivent d’amour et
d’eau fraiche. Il décide de quitter son métier pour devenir
marionnettiste au numéro 2 de la rue de la Boucherie dans le
quartier Saint Paul pour la joie des habitants du quartier,
puis le succès aidant à tous les lyonnais. Preuve de sa vivacité,
Guignol a célébré son bicentenaire en 2008 et un musée théâtre
lui est consacré à Brindas et on y découvre tous les personnages
qui accompagnent Guignol, dont la toute première marionnette
de Guignol fabriquée par Laurent Mourguet lui-même.
Note : Dans le parler lyonnais, dont le vocabulaire est particulièrement
riche et imagé, on dit gone pour gosse, nom affectueux pour
désigner un enfant.
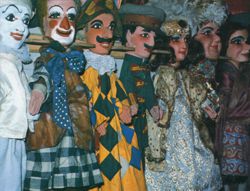
Si Guignol est le personnage lyonnais par excellence , la table lyonnaise est aussi un grand monument avec pour maître d’œuvre des restaurateurs qui ont fait la renommé internationale de la gastronomie française. Que ce soit Paul Bocuse, la Mère Brazier, ou les Terrasse de Lyon, tous ont à cœur de vous faire découvrir l’art de la table. Et puis pour les curieux, les célèbre « Bouchons Lyonnais » où l’on peut déguster les « Pieds Paquets, le Tablier de Sapeur, le Ragout de Béatilles, la Quenelle, la Bugne … » et autres « Matafins », sans oublier la cochonnaille, avec son fleuron l’Andouillette de Lyon et son mystérieux « doigt de morts à la Lyonnaise »
Contes et légendes d'hiver
Plan du site |
Moteur de recherche
| | Page Aide |
Contact
© C. LOUP 2025
.