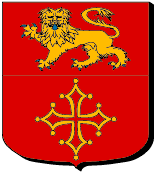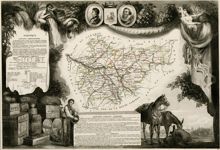Histoire du Tarn et Garonne
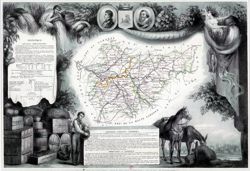
Lorsque, en 1808, Napoléon ler traversa le midi de la France, il passa à Montauban. Touché par les plaintes des habitants, qui gémissaient de voir leur glorieuse ville si industrieuse et si peuplée réduite à l'humble rang de chef-lieu d'arrondissement, il traça sur-le-champ, aux dépens des cinq départements du Lot, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne et du Gers, la circonscription d'un département nouveau dont Montauban fut le chef-lieu. Un sénatus-consulte du 2 novembre 1808 consacra la volonté impériale. Si la nouvelle division rendait à Montauban un rang digne d'elle, celle que l'Assemblée constituante avait précédemment établie était cependant préférable au point de vue historique, puisqu'elle concordait jusqu'à un certain point avec l'ancienne division provinciale. Le département de Tarn-et-Garonne, au contraire, fut formé sur un point limitrophe de cinq provinces anciennes dont chacune lui donna un lambeau il se compose, en effet, du bas Quercy et d'une partie du haut Languedoc, de l'Agenois, de la Lomagne et de la basse Marche du Rouergue. C'est assez dire que ce département n'a pas d'histoire qui lui soit propre et que nous sommes dans l'obligation de renvoyer le lecteur à celle des cinq départements énumérés plus haut. Nous rappellerons cependant en peu de mots le sort des provinces qui ont contribué à le former.
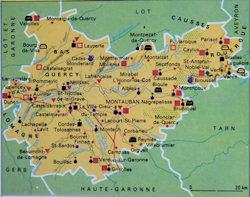
Le Quercy était occupé, à l'époque de l'invasion romaine, par les Cadurci. Il fut compris, après la conquête, dans l'Aquitaine, plus tard dans l'Aquitaine Ier. Les Wisigoths l'occupèrent au Vème siècle et en furent dépossédés au vil, par les Francs. Les rois francs successeurs de Clovis se partagèrent l'Aquitaine, et le Quercy-échut à ceux d'Austrasie. Au commencement du VIII siècle, Eudes, duc d'Aquitaine, s'en rendit maître et sa famille continua d'y régner jusqu'à la conquête qu'en fit Pépin le Bref en 768. Il resta soumis à l'autorité plus ou moins effective des Carlovingiens jusqu'à la naissance du régime féodal. Les comtes de Toulouse le possédèrent alors aussi longtemps que dura leur puissance, anéantie en 1229 par le traité de Meaux. Réuni ensuite à la couronne de France, il fut abandonné aux Anglais par le traité de Brétigny signé en 1360 ; mais Charles V le leur enleva, et depuis lors il n'a plus été détaché de la monarchie, Montauban était la capitale du bas Quercy, tandis que le haut Quercy avait pour capitale Cahors.

Le Rouergue était occupé par les Rutheni.
Son histoire est à peu près la même que celle du Quercy. Il
fut aussi compris dans l'Aquitaine Ier conquis successivement
par les Wisigoths, les Francs, Eudes d'Aquitaine et Pépin le
Bref: Il eut, à l'époque féodale, des comtes particuliers ;
passa à la maison d'Armagnac, qui le transmit elle-même à celle
de Navarre, et fut enfin réuni par Henri IV à la couronne de
France. Le Rouergue, dont la capitale était Rodez, se divisait
en haute et basse Marche. La partie orientale du département
de Tarn-et-Garonne (Caylus, Saint-Antonin) appartenait à la
basse Marche de Rouergue. Le Quercy et le Rouergue formaient,
avant la Révolution, une généralité dont Montauban était la
capitale c'est ce que l'on appelait la Haute Guyenne, avec une
assemblée provinciale parlictilière. L'Agenois, ancien pays
des Nitiobriges, offre à peu près les mêmes vicissitudes dans
son histoire que les provinces dont nous venons de parler et
suivit le sort de la Guyenne il a fourni la partie occidentale
de notre département (Moissac). A la vicomté de Lomagne le département
deTarn- et-Garonne doit la partie sud-ouest de son territoire,
sur la rive gauche de la Garonne (Beaumont-de-Lomagne, etc.).
Cette vicomté, située jadis dans le bas Armagnac, suivit le
sort de la province dont elle dépendait et appartient aujourd'hui
presque entièrement au département du Gers.
Enfin le haut
Languedoc formait le long de la Garonne, entre les diverses
provinces dont nous venons de parler une pointe où se trouvaient
situés Castelsarrasin, Montech, etc. C'est cette pointe qui
a été incorporée, assez naturellement du reste, au département
de Tarn-et-Garonne.
Quant à l'histoire du Languedoc, nous
n'en dirons rien ici et nous renverrons ait département de la
Haute-Garonne.
Par ce que nous venons de dire on peut juger
que le département de Tarn-et-Garonne a eu sa part à peu près
de tous les événements considérables du midi de la France. Guerre
des Francs et des Aquitains, guerre des Albigeois, guerre des
Anglais, guerres de religion. Nous ne reviendrons sur ces événements,
racontés ailleurs dans leur ensemble, que pour les détails particuliers
aux localités de notre département. Quoique le département de
Tarn-et-Garonne ne soit pas des plus remarquables en fait d'antiquités,
nous n'omettrons point de dire cependant qu'il possède plusieurs
dolmens druidiques à Septfonds, Bruniquel, Saint-Antonin, Loze,
Saint-Projet, etc. des tumulus dont le plus remarquable est
celui du Bretou des buttes, des camps retranchés, des restes
de camps romains à Gandalon, à Asques et à Bouloc, et quantité
de ruines romaines et du Moyen Age.
Montauban


L'origine de cette ville remonte à l’année
1144. Elle doit sa fondation à la haine d'une oppression qui,
de toutes, était là plus odieuse parce qu'elle attaquait là
pudeur, le droit de possession et les sentiments délicats auxquels
les hommes attachent le plus de prix. Sous le régime féodal
; la plupart des seigneurs avaient introduit le droit odieux
de coucher avec la nouvelle mariée d'un de leurs vassaux, la
première huit des noces et avant que l'époux entrât dans le
lit ; privilège indécent que les seigneurs exercèrent pendant
trop longtemps sur les nouvelles épousées de leurs fiefs. Ce
droit, appelé prélibation, cuissage, prémices où déflorent,
qui prouve l'excès de la barbarie des mœurs, de la frénésie
délirante des seigneurs féodaux et l'esclavage des peuples,
était perçu non seulement par les seigneurs laïques, mais encore
par les moines, les abbés et les évêques.
Les abbés du monastère
de Montauriol exerçaient ce droit dans toute sa plénitude sur
leurs jeunes vassales. En 1144, les habitants, indignés de ce
honteux assujettissement, réclamèrent la protection d'Alphonse,
comte de Toulouse, leur seigneur suzerain. Celui-ci, ne pouvant
priver l’abbé de ses droits seigneuriaux, offrit aux habitants
de leur accorder sa protection et des privilèges, s'ils voulaient
venir s'établir au bas d'un château assez voisin de l'abbaye
qui lui appartenait. Le local était beau et dans une situation
avantageuse; le désir des habitants était grand de secouer le
joug des abbés ; bientôt le bourg de l'abbaye fut déserté, et
le nouvel emplacement promptement couvert d'habitations.
Alphonse et Raimond son fils donnèrent à la nouvelle ville qui
s'accrut rapidement le nom de Mons Albanus, d'où s'est formé
celui, de Montauban. L’acte de cession daté du mois d'octobre
1144, porte la clause expresse que la ville ne sera jamais vendue,
engagée ni inféodé ni changée en un autre lieu.
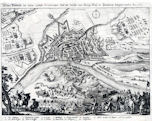
L'abbé de Montauriol ne vit qu'avec peine
ses sujets peupler là cité bâtie par le comté de Toulouse ;
il n'avait point de soldats à opposer, à ce prince, mais l'autorité
papale pouvait, le faire triompher: Eugène III reçut la plainte
que l'abbé lui présentai, et chargea l’archevêque de Narbonne
et l'évêque de Toulouse de poursuivre vivement le comte. Il
ordonna, de plus, que dans le cas ou Raimond refuserait de restituer
à l'abbé et ses vassaux et ses donas qui formaient là plus grande
partie de la population de la nouvelle ville, celle de Toulouse
; serait mise en interdit, avec défense d'y administrer d'autres
sacrements que le baptême et la pénitence et en cas de nécessite
urgente seulement ; c'est-à-dire, que les Toulousains devaient
être punis du prétendu crime de leur seigneur parce que celui-ci
avait bâti une ville pour recevoir des malheureux échappés à
la tyrannie et aux vexations atroces de quelques, moines. La
démarche de l'abbé obtint, un plein succès; le comte de Toulouse
fut forcé de céder la moitié de la souveraineté, des rentes,
et des droits de Montauban, ainsi que de toutes les terres qu'il
possédait, entre les rivières du Tarn et de l'Aveyron. Ainsi,
les moines en perdant quelques droits odieux, accrurent leur
puissance et leurs revenus.

Lorsque le Quercy fut soumis aux Anglais,
Montauban ne voulu reconnaitre l’autorité du prince de Galles
qu'après que ses magistrats eurent reçu un ordre exprès du roi
de France. Ses portes venaient à peiné d'être ouvertes à l'étranger
que Jean Chandos y mit une garnison de 500 hommes. Bientôt la
tyrannie étrangère excita l’indignation générale. Soixante villes
du Quercy se soulevèrent à la fois ; le prince jeta en vain
un nombreux corps de troupes dans Montauban, ses soldats furent
chassés et dans la, suite, les Anglais n'osèrent qu'en tremblant.
approcher de cette Ville.
Comme ils en connaissaient l'importance,
ils construisirent dans le voisinage quatorze forts pour l'affamer
et la bloquer entièrement. Une nuit même ils s’introduisirent
dans la ville et massacrèrent une partie des habitants, mais
les autres vengèrent la mort de leurs concitoyens, et tous les
ennemis furent passés au fil de l'épée.
Montauban fut une
des premières villes qui embrassèrent les dogmes de la Réforme,
et une de celles qui eurent le plus à souffrir des conséquences
de ce changement de religion. En 1560, Jean de Lettes, évêque
de Montauban, et son official, avaient déjà embrassé le calvinisme
lorsque les ministres Crescent et Vignaux vinrent prêcher publiquement
la réforme. On essaya vainement de s'opposer aux progrès, des
sectaires qui, devenus très nombreux, s'emparèrent des églises
et en chassèrent les prêtres catholiques. Le féroce Montluc
tenta d'assiéger Montauban, mais il se vit bientôt obligé de
l'abandonner. Depuis, cette ville devint le théâtre de la guerre
et du fanatisme. Les habitants poussèrent le zèle de la défense
jusqu'à l'héroïsme ; on vit de ces traits de courage, de fermeté,
dignes des républicain
Après la mort de Henri IV, Montauban,
qui était une des places, de sureté des protestants affecta
souvent une entière indépendance. En 1621, cette ville entra
dans la révolté général des calvinistes. Le comte d'Orval, fils
du duc de Sully, en eut le commandement, des retranchements
furent élevés au-delà de l’enceinte fortifiée. Cependant, Albias,
Négrepelisse, Caussade et Bruniquel, étant tombés au pouvoir
des royalistes, Montauban y fut serré de près. Louis XIII s'avança
vers la ville qui fut investie de trois côtés le 19 aout 1621.
Tout ce que la cour avait de guerriers illustres vint prendre
part à ce siège ; le duc de Mayenne y fut tué en attaquant le
quartier du Moustier. Dans tous les combats, dans tous les assauts;
les Montalbanais furent vainqueurs ; les femmes même prirent
les armes, se formèrent en corps régulier et combattirent sur
les remparts. Enfin, le 7 novembre, l'armée royale, affaiblie
et humiliée fût forcée de lever le siège après trois mois de
tranchée ouverte.
En 1678, des impôts extraordinaires occasionnèrent
une révolte dans la Guyenne; les protestants du Quercy, invités
à prendre part a la sédition, s'y refusèrent constamment.

Cet acte de fidélité fut, quelques années après, récompensé par des persécutions atroces, connues sous le nom de dragonnades. Montauban était entièrement habitée par des protestants que l'on résolut de convertir de force au catholicisme ; la ferveur de ces religionnaires était entretenue par le souvenir de ce qu'avaient souffert leurs pères pour la liberté de conscience : il n'y eut aucune conversion volontaire. Les moyens ordinaires pour convertir les obstinés étaient l'exclusion de toutes les charges et de tous les emplois honorables ; les récompenses données à tous ceux qui se faisaient catholiques ; le logement forcé des gens de guerre; les galères infligées aux ministres du culte réformé ; les procédures prévôtales contre les protestants qui s'assemblaient, etc. Ces moyens ne suffisant pas, on imagina les dragonnades. On ne sait, dans celle circonstance, qui l'on doit trouver les plus criminels, ou les ministres du roi qui osèrent employer ses troupes contre de faibles sujets et déclarer la guerre aux mères de famille, aux chefs de maison, aux enfants encore sous la garde de leurs parents, ou les lâches soldats qui, oubliant les droits sacrés de l'honneur et de l'a justice, se chargèrent d'une aussi méprisable commission. Les dragons vivaient à discrétion chez les protestants ; il y en eut un régiment entier établi à Montauban. Les uns se faisaient donner tout ce qui leur plaisait, occupaient les belles chambres des maisons, obligeaient les enfants et les femmes à se servir dans les choses les plus sales, exigeaient des contributions, arrachaient le nécessaire aux familles et les réduisaient à l’indigence, les autres, par un raffinement inhumain, leur interdisaient sans pitié le sommeil, en se faisant bercer le jour et là nuit ; ceux-ci insultaient ouvertement à la pudicité du sexe et à l'honneur des maris, ceux-là forçaient des citoyens infortunes à racheter leur subsistance et leur repos au prix de leur honte et de leur infamie ; enfin, ils se permettaient des actions telles qu'en commettent seuls les brigands. Si quelque digne magistral, désespéré de voir l'autorité du roi aussi honteusement avilie, écrivait au. ministre, on lui répondait : «Sa Majesté veut qu'on fasse éprouver les dernières rigueurs à ceux qui ne voudront pas se faire de sa religion ; et ceux qui auront la sotte gloire de demeurer les derniers, doivent être poussés jusqu'à la dernière extrémité. Qu'on juge, après un pareil ordre, dicté par le barbare Louvois, de ce que les zélés, les faux dévots et les bas valets de cour devaient oser et faire.

La ville de Montauban est bâtie sur un plateau qu'entourent le Tarn, le Tescou et un profond ravin ; ce plateau est élevé de 60 à 90 pieds au-dessus des deux rivières, et de ce côté ses pentes sont très rapides. Placée sous, un beau ciel, baignée par un fleuve navigable, environnée de plaines fertiles, cette ville est devenue, une place importante, et sa prospérité augmentera beaucoup encore lorsque le canal du Midi sera prolongé jusque sous ses murs.
La ville proprement dite n'est pas très-grande, mais les faubourgs, où se trouvent les principales manufactures, sont remarquables par leur beauté et par leur étendue; on distingue surtout celui de Ville-Bourdon, qui a été bâti par des protestants chassés de Toulouse en 1562. Ces faubourgs communiquent avec la ville par un vaste pont en briqué, d'une apparence gothique et d'une grande solidité, formé de sept grandes arches en ogive. Au bout de ce pont et du côté des faubourgs, s'élève une porte en forme d'arc de triomphe, à l'autre bout est l'hôtel-de-ville, beau et grand bâtiment carré, flanqué de quatre pavillons; à côté est l'église, Saint-Jacques, surmontée d'un haut clocher en brique composé de quatre rangs d'arceaux et surmonté, d'une flèche. L'intérieur de la ville n'offre rien de bien remarquable, la plupart des rues sont étroites et mal pavées ; celles des faubourgs sont droites, larges et fort propres. Les anciennes maisons sont en brique et à toits qui projettent beaucoup au-dessus des rues, ce qui les rend un peu sombres; les constructions modernes sont gracieuses et élégantes. Montauban renferme trois belles places qui sont celles de la Préfecture, la place d'Armes et la place Royale; cette dernière est spacieuse, carrée, bordée de maisons propres et régulières, à façades décorées de doubles portiques en brique; à chaque angle débouche une porte d'un bon style.

La préfecture est un beau bâtiment élevé
sur une place qu'orne encore le grand et somptueux café de l'Étoile.
Là, commence l'avenue dite des Acacias, que six rangs d'acacias
ombragent ; elle mène aux Terrasses : ce sont de charmantes
promenades qui bordent la crête de la colline du Tescou, et
qui sont soutenues par des murs très-hauts, seuls restes des
anciennes fortifications de Montauban. De cette position, peu
ombragée encore, mais très fréquentée, on jouit de perspectives
étendues et ravissantes. La vue se promène sur la riche et fertile
vallée du Tarn et les riantes collines, du Tescou, sur la magnifique
plaine intermédiaire qui semble un parterre, un vergé continuels,
puis, plongeant dans un vaste horizon, y cherché, à travers
les nuages -et les vapeurs les formes fugitives des Pyrénées.
Quand le temps est favorable, cette chaine se distingue nettement
dans presque sa totalité quoique éloignée de quarante à cinquante
lieues de Montauban. L’horizon semble décrire un arc de cercles
d’une merveilleuse longueur et présente une formidable barrière
de monts hérissés de pics et surchargés de neiges éternelles.
Les environs de Montauban. offrent encore d'agréables promenades
sur les bords du Tarn qui sont embellis au dessus de la ville
par une cascade artificielle, assez haute et d'une grande longueur
formée par une levée qui barre obliquement la rivière. Au dessous
de là ville, on remarque une cascade semblable, une jolie ile
couverte de saule et un grand et pittoresque moulin, dont là
forme est celle d'un château
Castelsarrasin
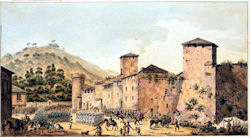
Cette ville est bâtie au milieu d'une vaste et fertile plaine, dans une situation agréable, sur la petite rivière d'Azine et près de la rive droite de la Garonne. Quelques auteurs pensent qu'elle existait déjà du temps des Sarrasins, mais l’on a lieu de croire qu'elle est moins ancienne; elle était toutefois Connue dès le XIIe siècle. Le parlement de Toulouse, y chercha un asile contre les dernières fureurs de la Ligue . Castelsarrasin est une ville propre et bien bâtie. Elle était autrefois entourée de murs et de fossés, que d'agréables promenades ont remplacés. Quelques restes de remparts, deux portes parfaitement semblables à celles de Toulouse, et le portail gothique de l'église paroissiale, sont les seuls restes d'anciennes constructions que l'on y remarque.
Pompignan-le-Franc
Pompignan ou Pompignan-le-Franc, est
une petite commune de 640 habitants, située dans le canton de
Grisolles, sur la route de Montauban à Toulouse, à 33 kilomètres
au sud-est de Castelsarrasin.
Nous la citerons à cause du
poète devenu doublement célèbre par ses vers et par les railleries
de Voltaire.
Jean-Jacques
Le Franc, marquis de Pompignan, naquit à Montauban en 1709.
Son père était premier président de la cour des aides de cette
ville, et lui-même remplit plus tard les mêmes fonctions. Ses
odes, sa tragédie de Didon et ses cantiques sacrés le conduisirent
à l'Académie en 1760 ; mais il étala dans son discours de réception
un zèle religieux et une animosité contre les philosophes qui
attirèrent sur lui les attaques des encyclopédistes. Voltaire
lui décocha sur-le-champ toutes ses épigrammes en prose et en
vers, les Si, les Quand, les Mais, les Pourquoi, et le harcela
de ces railleries que toute la France répétait.

Pompignan, qui manquait de tact, fit
un peu plus tard une maladresse encore plus lourde. S'étant
retiré à Pompignan, il y fit consacrer solennellement l'église,
reconstruite par ses soins, et publia un écrit qui exposait
toute la pompe de cette cérémonie, énumérant avec complaisance
les gens de qualité qui s'y trouvaient, sans omettre les jésuites,
faisant le compte des moindres détails et ne faisant pas grâce
d'un seul cierge. Voltaire s'en empara aussitôt et fit cette
chanson fameuse
Nous avons vu ce beau village
De Pompignan,
Et ce marquis brillant et sage,
Modeste et grand,
De ses vertus, premier garant ;
Et vive Louis
Et
Pompignan son favori !
Il a recrépi sa chapelle
Et
tous ses vers;
Il poursuit avec un saint zèle
Les gens
pervers ;
Tout son clergé s'en va chantant :
Et vive
Louis
Et Pompignan son favori
En aumusse un jeune
jésuite
Marchai devant ;
Gravement venait à sa suite
Sieur Pompignan
En beau satin de président.
Et vive Louis
Et Pompignan son favori !
C'est encore Voltaire qui
disait des Cantiques sacrés de Pompignan « Sacrés ils sont,
car personne n'y touche. » Cependant il rendit sincèrement hommage
au poète tant persiflé, lorsqu'un jour La Harpe, lui ayant lu
l'ode célèbre sur la mort de J.-B. Rousseau, il s'écria « Ah
mon Dieu ! que cela est beau » C'est, en effet, dans cette ode
que se trouvent deux des plus magnifiques strophes qui existent
dans la langue française. Quoiqu'elles soient dans la mémoire
de tous, nous ne pouvons résister au désir de les citer ici
:
Quand le premier chantre du monde
Expira sur ces
bords glacés
Où l'Èbre effrayé dans son onde
Roula ses
membres dispersés,
Le Thrace errant sur les montagnes
Remplit les bois et les campagnes
Du cri perçant de ses douleurs
;
Les champs de l'air en retentirent,
Et dans les antres
qui gémirent
Le lion répandit des pleurs.
……………………
Le Nil a vu sur ses rivages
Les noirs habitants des déserts
Insulter par leurs cris sauvages
L'astre éclatant de l'univers
!
Cris impuissants ! fureurs bizarres !
Tandis que ces
monstres barbares
Poussaient d'insolentes clameurs,
Le
dieu poursuivant sa carrière
Versait des torrents de lumière
Sur ses obscurs blasphémateurs.
Les restes de Le Franc
de Pompignan reposent dans l'église paroissiale.
Jean-Auguste-Dominique Ingres
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025.