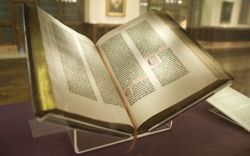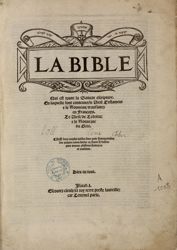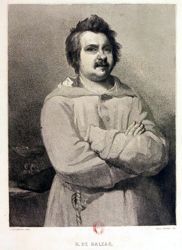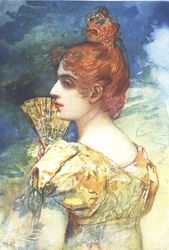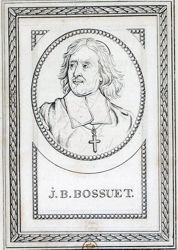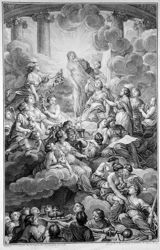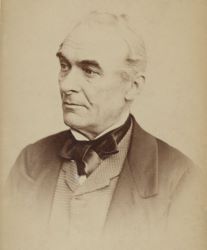Introduction
Notre pays possède de très beaux paysages, des
cours d’eau impétueux, des villes magnifiques, des villages aux charmes
incontestables, des montages grandioses, des forêts, des lieux fabuleux,
des champs où paissent des vaches de différentes races. Des élevages,
de poules, de canards, d’oies, de dindes et autres volatiles, sans parler
d’autruches, de bisons, de lamas et même de crocodiles ! Des alpages
où des moutons sont présents par milliers, des cultures, ici du blé,
là de l’orge, ici des betteraves, ici encore de la vigne, et puis tant
d’autres choses.
Mais comment pourions-nous décrire toutes les merveilles
que notre pays possède, si nous n’utilisions pas un langage.
Notre
langue, comme beaucoup de choses ne s’est pas élaborée en un jour. Il
a fallu des siècles pour que le langage que nous possédons aujourd’hui
nous parvienne, tel que nous le pratiquons.
Pour vous donner un petit
aperçu du François tel que l’on l’écrivait et le parlait au temps de
Henri IV. Voici un très court quatrain extrait de la Satyre Ménippée
:
Qu’est-ce qu’a faict celuy que l’on encoffre ?
Des angelots
il avoit en son coffre.
O le méchant ! qu’au cachot il soit mis :
Il a logé cheux soy les ennemis.
Bien sûr, aujourd’hui nous
employons des mots qui n’existaient pas avant le XXème siècle.
Satellites, médias, smartphones, télévision, et autre courriels…
sans oublier les mots qui nous viennent d’autre pays comme le franglais*
qui est un mélange entre deux langues : par exemple Bifteck qui est
la forme francisée de l'anglais beefsteak, tranche de bœuf ; et bien
d’autres encore qu’il serait fastidieux d’énumérer, ce site n’étant
pas un dictionnaire.
Pour arriver au français, tel que nous le parlons,
il a fallu que des écrivains, des poètes, des orateurs, des scientifiques
élaborent, construisent, les mots que nous utilisons aujourd’hui.
![]() Du Latin, comme la France le parlait à l’époque de Rome. Comme les Celtes
qui peuplèrent notre pays, bien avant Rome, comme Les basques qui parlaient
leur propre langage, qui soit dit en passant, nul n’en connait l’origine,
(le grand Platon les disait Ancien peuple de l’Atlante).
Du Latin, comme la France le parlait à l’époque de Rome. Comme les Celtes
qui peuplèrent notre pays, bien avant Rome, comme Les basques qui parlaient
leur propre langage, qui soit dit en passant, nul n’en connait l’origine,
(le grand Platon les disait Ancien peuple de l’Atlante).
*Note
: Le franglais, mot-valise formé des mots « français » et « anglais
», désigne une langue française fortement anglicisée, dans l'expression
écrite comme orale. Il s'agit d'un ensemble de mots empruntés à l'anglais
et de tournures syntaxiques calquées sur l'anglais, introduits dans
la langue française. Il est fréquemment évoqué comme repoussoir par
les tenants de la « pureté » de la langue française, contre ce qu’ils
considèrent être une invasion des anglicismes.
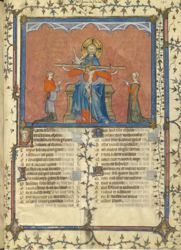
Le parler François
Bien sûr, nous n’avons pas la prétention de dire
que le français est la plus belle des langues et que les plus grands
écrivains sont français, les Anglais pourraient prétendre la même chose
avec William Shakespeare, de même que les Italiens avec Giovanni Boccaccio,
ou bien encore les Allemands avec Johann Wolfgang von Goethe, sans oublier
l’Espagne avec Miguel de Cervantès Saavedra. Chaque pays a ses propres
auteurs qui à leur façon ont forgé la langue de leur pays.
Pour
la France, longtemps coupée en deux par deux langues qui ne se comprenaient
pas entre-elles, le Nord parlait le langue d’Oïl, étant le lointain
ancêtre du français d’aujourd’hui avec une influence des dialectes germaniques
importés en France par les Francs. La langue d’Oc avec de profondes
racines grecs et qui est le Provençal de nos jours. Combien d’années
il fallut pour transformer les mots Meffire en Monsieur, Ma Dame, en
Madame, j’avois en j’avais ; etc.
Et n'oublions pas les patois de
nos provinces, le Berrichon, qui ne peut pas parler à un Limousin, qui
lui non plus ne comprends pas l’Auvergnat, qui lui non plus ne peut
pas dialoguer avec un Savoyard et qui pour lui l’Alsacien est assimilé
à du chinois, sans parler du Béarnais qui ne comprend pas ce que lui
conte un Breton. Et puis tant d’autres, il arrive même que sur un même
territoire, ils ne se comprennent pas d’une vallée à l’autre !
Ces
patois, ces dialectes locaux sont une des grandes richesses de notre
pays et hélas ! ces dialectes locaux sont appelés à disparaître car
très peu de notre jeune génération l’utilise, pour l’unique raison qu’il
n’y a pas d'enseignement.
Mon but n’est pas de vous faire un exposé
sur l’histoire de la langue française, mais il m'a paru utile de vous
présenter un aperçu très complet des hommes qui ont forgé notre langue.
Dans cette page, vous découvrirez des notices succinctes d’auteurs,
certains très connus, ainsi que d’autres moins connus. Tous ont contribué
eux aussi à la rédaction d’une page de l’ouvrage qu’est le grand dictionnaire
de la langue Française.
Vous pouvez visiter le site de l’Académie
Française en cliquant
ici

L'histoire de la littérature française se divise
naturellement en six périodes.
La première comprend les origines.
C'est alors que s'agitent et se mêlent les éléments d'où doit sortir
la langue française.
La deuxième s'étend du XIèmeau XVIème
siècle, c'est-à dire du moment où, par suite des combinaisons diverses
de l'idiome primitif du pays avec celui des Romains et des populations
envahissantes, il ne reste plus en France que les deux langues d'oc
et d'oil. Alors, enfin, le langage est constitué, et quand par un travail
de quatre siècles, il aura tiré de lui-même tout ce qu'il renferme,
il ne lui restera plus qu'à se perfectionner et à se polir au contact
des langues savantes de l'antiquité.
Pendant cette période, le mouvement
philosophique reste séparé du mouvement littéraire. Il se produit sous
la protection de l'Église, à qui il emprunte ses tendances spiritualistes
et son idiome : L'esprit humain essaye ses forces et cherche sa voie.
Il semble se perdre longtemps dans les recherches abstraites et souvent
puériles cependant des étincelles jaillissent parfois de ces ténèbres,
et quelques voix puissantes, mais isolées, s'élèvent en faveur de l'indépendance
de la raison.
« Au XIVème et au XVème
siècle, dit AI. J. Demogeot, autre spectacle non moins frappant la science
s'émancipe d'une tutelle longtemps bienfaisante ; l'Église n'est plus
le seul pouvoir moral, l'esprit humain commence à s'affranchir.» Bientôt
il se fortifie par l'héritage de l'antiquité la tradition grecque et
latine reparaît dans tout son éclat. Le XVIème siècle est
comme le confluent où les deux courants de la civilisation ; le christianisme
et l'antiquité, se rejoignent. »
De toutes parts, la lutte s'établit
: lutte religieuse, lutte philosophique et politique, qui ébranle le
monde tout entier, et qui se termine, d'un côté, par l'édit de Nantes,
c'est-à-dire par la proclamation du dogme de la tolérance civile de
l'autre, par le déplacement du principe d'autorité, qui passe de l'Église
dans l'État. Mais dès lors le scepticisme en matière philosophique et
religieuse a remplacé la foi profonde des âges précédents.
En littérature,
le mouvement, pour être moins violent dans ses manifestations, n'en
sera pas moins réel.
Le XVIème siècle est le siècle de
la Renaissance. C'est alors que s'allient et se fondent les éléments
de la civilisation chrétienne avec les traditions de l'antiquité. A
la vue de ces chefs-d’œuvre inconnus, le génie français s'anime d'une
vive émulation et à ses qualités propres il ajoute par une sorte d'assimilation
celles dont la Grèce et Rome lui ont légué de si brillants modèles.
Il fallut un siècle pour achever ce travail intérieur.
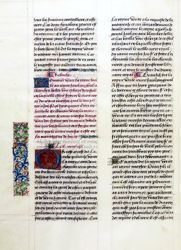
Mais aussi il eut pour résultat de rendre possible
la plus brillante période de notre littérature. Alors la langue s'est
assouplie, enrichie elle a emprunté aux écrivains de l'antiquité quelque
chose de leur ampleur et de leur majesté. La verve et l'élan du génie
français ont appris de ces modèles à se régler et à se contenir. Le
goût s'est formé, et l'écrivain ne se laisse plus entraîner aux écarts
et aux caprices de son imagination.
Au milieu de tous ces perfectionnements
de la langue et de la littérature, l'intelligence humaine, longtemps
accablée sous sa propre ignorance, se relève, s'éclaire peu à peu et
se prend elle-même pour sujet de son étude. Le doute, le scepticisme,
résultat des luttes du siècle précédent, devient entre les mains de
Descartes une méthode pour trouver le vrai en fondant la certitude sur
l'évidence, il détruit le principe d'autorité et assure l'indépendance
de la pensée. Comme lui et avant lui, Corneille avait pris pour base
la personnalité morale et libre, et cette tendance spiritualiste est
le lien commun et le caractère des grands génies de ce siècle.
Après
le XVIIème siècle tout est fait pour la langue, et la philosophie
a trouvé sa base et sa méthode. Les transformations que nous avons suivies
jusqu'à présent, de littéraires, deviennent morales elles passent de
la langue à l'homme, et la philosophie remplace ou pénètre la littérature.
On ne se contente plus d'admirer, et l'art ne suffit pas. Une ardente
et noble curiosité s'empare de l'homme. On veut tout sonder, tout connaître.
On s'attaque aux principes jusqu'alors presque incontestés qui régissent
le monde ; tout est remis en question, religion, société, gouvernement,
et le XVIIIème siècle représente moins une littérature qu'une
bataille acharnée pour conquérir des droits et des vérités nouvelles.
C'est une révolution qui se prépare, et souvent par les mains de ceux
mêmes contre qui elle s'accomplira.
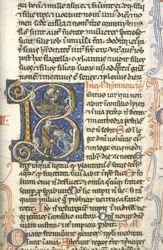
Au XIXème siècle comme au XVIIIème, la littérature n'a qu'un but, la recherche dit vrai en soi en dehors de toute autorité. Mais si le principe est le même, les manifestations en sont différentes, parce que la société qu'elle représente a changé.Une révolution nouvelle s'est faite, à laquelle le XVIIIème siècle n'avait pas songé, révolution littéraire, raisonnable par son principe, souvent exagérée dans ses premières manifestations, et qui s'est terminée par une alliance féconde et durable de la sévérité de la littérature classique avec les principes plus larges qu'apportaient les novateurs. De ce mouvement intellectuel nous allons voir quelle part revient à chaque partie de la France, où plutôt nous allons tâcher d'en donner une idée sommaire en passant en revue le mouvement littéraire de chaque province, en tâchant de marquer le caractère distinctif de chacune d'elles et le rôle qu'elle a joué. Dans ce rapide tableau, nous emprunterons souvent le secours d'un éminent historien, celui peut-être de tous nos contemporains qui a le mieux compris, senti le génie de la France, parce que nul ne l'a plus aimée, Jules Michelet.
La Bretagne
La Bretagne a été le dernier refuge de l'indépendance celtique. C'est par elle que nous commencerons. C'est là, au milieu des rochers et des forêts qui leur servaient d'asile, que se sont réfugié les restes des antiques populations de la Gaule. Sans cesse en lutte contre un sol et une nature rebelle, ils semblent s'y être d'autant plus attachés. C'était pour eux le dernier sanctuaire de leurs dieux et l'image de la grande patrie qui leur était enlevée. C'est là, dans les hameaux, dans les campagnes, que se conservait vivante la vieille langue des aïeux, la langue celtique. Les bardes chantaient les hymnes des dieux et la gloire des guerriers. Comme leurs frères du pays de Galles, les Armoricains ont recueilli les chants de leurs bardes, dont la plupart ne se sont perpétués que par la tradition et la mémoire. Mr. de La Villemarqué, dans ses Chants populaires de la Bretagne, en cite un, entre autres, du barde Gwenchlan, que les paysans bretons appellent La prédiction et qui offre tous les caractères de la poésie des bardes du Vème et du VIème siècle. C'est un chant de guerre contre les envahisseurs, prélude de cette longue résistance qui a fait de la Bretagne une contrée longtemps séparée de la France, et qui s'est prolongée jusqu'au XVIème siècle. C'est là enfin qu'au siècle dernier s'est soutenue le plus longtemps la lutte contre les idées nouvelles et le gouvernement institué par la Révolution. Partout dans l'histoire de cette province nous trouvons la résistance et l'opposition, et ce caractère est plus saillant encore dans l'histoire de la philosophie et de la littérature.

Pélage était Breton, et le premier il osa opposer au dogme de la grâce le principe de la liberté, et proclamer que l'homme peut, par la seule puissance de sa volonté, s'abstenir du péché. Il eut pour successeur au XIIème siècle Pierre Abailard, né dans le diocèse de Nantes, en 1079, mort en 1142. On connaît l'invincible obstination qu'il apporta dans sa lutte avec saint Bernard. A son école, établie sur la montagne Sainte-Geneviève, se pressait une foule immense d'écoliers, accourus de toutes parts pour l'entendre. « Abailard établit en principe ce qui jusqu'à lui n'avait été qu'une tendance incertaine, l'application de la dialectique aux dogmes de la religion. Il veut prouver la foi c'était la supposer douteuse. C'était surtout reconnaître à côté ou même au-dessus d'elle une autorité différente dont elle devait recevoir l'investiture. » Pélage et Abailard peuvent être considérés comme les précurseurs de Descartes, sinon pour l'ensemble de leurs doctrines, au moins pour leur révolte contre le principe d'autorité. Descartes, quoique né à La Haye en Touraine, appartient à la Bretagne par sa famille, et la trempe de son génie l'y rattache bien plus qu'à la Touraine. C'est lui qui a complété l'œuvre de la philosophie tentée par Pélage et Abailard. En fondant son principe, en dehors de la foi et de la révélation, sur l'évidence dont la raison est nécessairement le seul juge, il a à jamais marqué la séparation entre la philosophie et la théologie ; il a rendu à l'intelligence humaine son indépendance et fondé sur une base inébranlable l'édifice de nos connaissances. « Dès que le Discours sur la Méthode parut, à peu près en même temps que le Cid, dit Mr. V. Cousin, tout ce qu'il y avait en France d'esprits solides, fatigués d'imitations impuissantes, amateurs du vrai, du beau et du grand, reconnurent à l'instant même le langage qu'ils cherchaient. Depuis on ne parle plus que celui-là ; les faibles médiocrement, les forts en y ajoutant leurs qualités diverses, mais sur un fond invariable devenu le patrimoine et la règle de tous. »
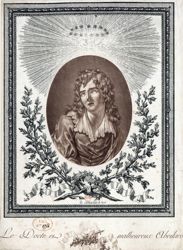
C'est à Rennes que sont nés l'intrépide La Chalotais,
l'ennemi implacable des jésuites, qui paya son courage de sa liberté,
et qui du fond de son cachot écrivait avec un cure-dent ses éloquents
mémoires ; Fréron, l'infatigable adversaire de Voltaire ; Lanjuinais,
qui osa combattre les jacobins tout-puissants et résister aux volontés
de Napoléon ; Geoffroy, le continuateur de l'Année littéraire, et qui
en 1793 rédigeait l'Amis du Roi.
« Cet esprit d'opposition naturel
à la Bretagne, dit Michelet, est marqué au dernier siècle et au nôtre
par deux faits contradictoires en apparence. La même partie de la Bretagne
(Saint-Malo, Dinan, Saint-Brieuc) qui a produit sous Louis XV les incrédules.
Duclos, Maupertuis et Lamettrie, a donné de nos jours au catholicisme
son poète et son orateur, Chateaubriand et Lamennais. »
Il y a peu
de pays qui aient produit à une même époque deux écrivains aussi éminents.
Atala, René, les Martyrs, les Natchez, le Dernier des Abencérages sont
des œuvres dont chacune suffirait pour immortaliser un nom. Nul poète
ancien ni moderne ne surpasse Chateaubriand dans ses descriptions, surtout
quand il peint la nature. Né à Saint-Malo en 1768, il était le dernier
rejeton, en ligne directe, de la maison de Châteaubriant. Il avait émigré
pendant la Révolution. Rentré en France en 1800, il publia, deux ans
après, le Génie du Christianisme, poétique tableau de la religion chrétienne
et très propre à y ramener les esprits au sortir des saturnales révolutionnaires.
« La vérité dans les ouvrages de raisonnement, écrivait Mr. de Bonald,
est un roi à la tête de son armée un jour de combat ; dans l'ouvrage
de Mr. de Chateaubriand, elle est comme une reine au jour de son couronnement,
entourée de tout ce qu'il y a de magnifique et de gracieux. »

Lamennais avec un génie égal a je ne sais quoi
de plus profond, de plus saisissant pour l'esprit. Sa sombre imagination
entraîne, subjugue, et ses tableaux revêtent parfois des couleurs effrayantes.
Quand parut l'Essai sur l’Indifférence, ce livre devint la préoccupation
de toute la France. Tout le monde a lu les Paroles d’un croyant, le
Livre du Peuple, et ceux mêmes dont il blessait les convictions ont
été contraints d'admirer ; mais c'est surtout dans son beau livre des
Esquisses que « l'auteur semble avoir atteint, dans le calme de la méditation,
la forme sereine et définitive de sa pensée. »
Cependant les écrivains
d'une province n'en représentent pas tous l'esprit, et cela est vrai
de tous les pays comme de la Bretagne. Les influences de l'éducation,
des déplacements ont souvent assoupli la rudesse de ce fier génie, et
plusieurs écrivains nous le présentent tellement modifié, qu'il serait
impossible dans un si rapide aperçu d'en déterminer les véritables traits.
Au moyen âge, nous retrouvons les bardes bretons chantant les hauts
faits du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde. Au XIIème
siècle, la Bretagne nous donne un de nos premiers écrivains, Guillaume
Le Breton, l'auteur de la Philippéide ; au XVème , Maillard,
prédicateur de Louis XI, dont les sermons macaroniques restent comme
un curieux monument de l'enfance de l'art; au XVIIème, l'abbé
La Bletterie, traducteur de Tacite l’abbé Neuville, célèbre prédicateur
; l'abbé Trublet, l'infatigable compilateur ; le père Bougeant, l'historien
du traité de Westphalie, qui tous, par la nature de leurs ouvrages,
échappent à l'influence du génie purement breton.
En 1668 naît à
Sarzeau l'immortel Lesage, ce peintre si habile et si piquant de son
siècle ; cet impitoyable frondeur des ridicules et des vices de son
époque, qui dans Gil Blase attaque la société tout entière, et dans
son Turcaret livre au ridicule la classe peut-être alors la plus puissante,
grâce à la détresse ou l'ambition du grand roi avait plongé la France.
On doit aussi à Lesage la spirituelle comédie de Crispin, rivale de
son maître, et le roman du Diable boiteux, si vanté par Walter Scott.
« Aucun livre, dit-il, ne contient plus de vues profondes sur le caractère
de l'homme et tracées dans un style aussi précis. » Pour clore cette
liste déjà si longue, nommons encore l'avocat Gerbier, Alexandre Duval,
qui a laissé au théâtre des ouvrages estimables. A Brest est née l'lmo
de Duras, dont la vie presque tout entière fut une lutte, et dont l'imagination
et les écrits reflètent les tristesses. Un nom contemporain terminera
cette nomenclature, Brizeux, le gracieux auteur de Maie et des Ternaire.
Poitou
C'est dans le Poitou que se sont livrées les
grandes batailles du Nord et du Midi, entre Clovis et les Goths, Charles-Martel
et les Sarrasins, le prince Noir et le roi Jean. « Mêlé de droit romain
et de droit coutumier, il fournit au nord ses légistes les Tiraqueau,
les Besly, les Brisson ; au midi, ses troubadours. Il est lui-même,
comme sa Mélusine, un assemblage de natures diverses. » (Michelet.)
En effet, le Poitou se divise géographiquement en trois zones du midi
au nord, et chacune d'elles est habitée par une population différente
dont il serait facile de déterminer le caractère. C'est là ce qui explique
les diversités que nous remarquons parmi les écrivains qu'a produits
ce pays. Cependant, le caractère général de cette province est un génie
d'opposition, moins opiniâtre peut-être que-celui de la Bretagne, mais
aussi plus vif et plus hardi dans ses manifestations. C'est dans le
Poitou que se livrent les grandes batailles du calvinisme et du catholicisme
; et ce même pays, qui au XVIème siècle recrutait les armées
de Coligny et tentait la fondation d'une république protestante, fournit
ces terribles soldats qui luttèrent si longtemps contre la Révolution
ait nom du catholicisme et de la monarchie.
Cette opposition se
manifeste dès le XIème siècle. Gilbert de La Porée, évêque
de Poitiers, fut comme Abailard, son collègue à l'école de Chartres,
en lutte avec saint Bernard. Condamné par le concile de Reims pour quelques
propositions trop hardies, il se rétracta. En général, la littérature
de cette province est sérieuse et sévère comme le caractère de ses habitants.
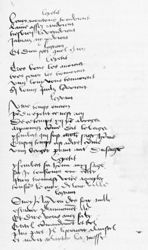
Le plus grand politique de la France appartient
au Poitou. Richelieu sortait d'une famille noble de cette province.
« Ambitionnant toutes les gloires, dit M. Demogeot, dans son Cours de
littérature, il s'était fait auteur dramatique. Il était père ou parrain
de Mirame, tragi-comédie signée par Desmarets, pour laquelle il fit
construire la salle magnifique du Palais-Cardinal (Royal). Il esquissait
parfois entre deux plans de campagne un plan de tragédie qu'il faisait
exécuter par sa brigade de poètes. On en comptait cinq Corneille, Bois-Robert,
Colletet, de L'Estoile et Rotrou. C'est ainsi que furent composés les
Tuileries, l’Aveugle de Sonyme et la Grande Pastorale. Chaque poète
faisait son acte ; le cardinal jugeait, corrigeait et payait. » Ajoutons
que ses Mémoires et la fondation de l'Académie française lui assurent
une place plus sérieuse dans l'histoire de la littérature.
A Niort
naquit Beausobre, qui a écrit l'histoire du manichéisme et celle de
la Réformation, que la mort l'empêcha d'achever. La même ville a donné
à la France Mme de Maintenon, dont le caractère et le rôle ont été diversement
jugés, mais dont certainement correspondance restera comme un modèle
de raison et de netteté. L'imagination poétique n'a pas manqué non plus
au Poitou.
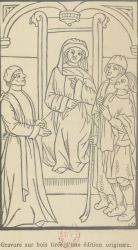
Pierre Blanchet est né à Poitiers en 1459. C'est
à lui qu'on attribue l'Avocat Patelin, le chef d'œuvre comique du moyen
âge. « L'intrigue n'est qu'un fil léger, dit encore Mr. Demogeot
; mais elle est nouée avec tant de naturel, conduite avec une si admirable
vérité ; elle fait passer devant nous des personnages si vivants, si
originaux, que cette farce est demeurée le plus ancien et l'un des meilleurs
types de la bonne plaisanterie gauloise. » Fontenay est la patrie
de Nicolas Rapin, l'un des spirituels et mordants auteurs de la Satire
Ménippée, qui, comme une seconde bataille d'Ivry, acheva la victoire
de Henri en ensevelissant la Ligue dans le ridicule.
A Niort est
né Fontanes, poète, orateur, et le plus célèbre représentant de la littérature
impériale. Le nom même de Voltaire peut être revendiqué par le Poitou,
d'où sortait sa famille ; on dit même qu'il y a encore des Arouet dans
les environs de Parthenay, au village de Saint-Loup.
La Saintonge et l'Angoumois
La Saintonge et l'Angoumois, placés entre la Guyenne et le Poitou, tiennent pourtant par leur esprit plus au nord qu'au midi. Comme le Poitou, ces provinces ont dans leur génie quelque chose de rude et de sévère, soit qu'elles doivent ces qualités à leur propre nature, soit qu'elles aient subi l'influence du calvinisme si longtemps florissant dans ces contrées. Ce sont elles qui ont donné naissance au plus vigoureux de nos poètes satiriques ; Agrippa d'Aubigné, dont les effrayantes satires sont teintes de si noires couleurs et respirent une si sombre énergie. La Rochefoucauld, poli, assoupli par l'usage de la cour, garde cependant une part de cette âpreté, et ses Maximes, sous une forme moins violente, sont encore une satire du genre humain.
Balzac, tout préoccupé de la forme qu'il veut imposer à la prose française, conserve au milieu de sa pompe solennelle je ne sais quelle raideur inflexible. Il prend, comme il le dit lui-même, autant de peine à travailler ses ouvrages que les anciens sculpteurs à faire des dieux. Et quand il rencontre une idée grande, un intérêt sérieux, la véritable éloquence éclate aussitôt, comme quand il développe la merveilleuse diffusion de l'Évangile, ou quand il montre la main de Dieu cachée derrière les événements de l'histoire. Cependant la grâce n'a pas manqué à ces provinces, et le caractère des écrivains qui ont précédé le temps des guerres religieuses montre assez combien ces luttes et ces doctrines ont influé sur le génie de cette contrée. En effet, c'est là que sont nés Octavien de Saint-Gelais et son fils, ou son neveu, Mellin de Saint-Gelais, ces poètes charmants de l'amour et des plaisirs, et la spirituelle Marguerite de Navarre, dont les Nouvelles si piquantes ont tant fourni aux conteurs des siècles suivants ; nouvelles « qu'elle composa, dit Brantôme, en ses gaietés, et la plupart dans la litière, en allant par pays car elle avoit de plus grandes occupations estant retirée. »A ces noms s'en joignent quelques autres moins connus peut-être, qui cependant ne méritent pas l'oubli: le bibliographe Coloniez ; l'agronome La Quintinie ; Gourville, le secrétaire du duc de La Rochefoucauld et plus tard son ami, ainsi que du prince de Condé; des Roches, dit de Parthenay, auteur d'histoires estimées Réaumur, si connu dans les sciences naturelles par ses découvertes, et qui mériterait de l'être dans la littérature par ses mémoires si curieux destinés à servir à l'histoire des insectes le président Dupaty, auteur de plusieurs ouvrages de jurisprudence, et qui doit surtout sa réputation à ses Lettres sur l'Italie ; et enfin, Vanderbourg, l'éditeur et en grande partie le créateur des poésies, d'une naïveté si étudiée et pourtant si touchante, faussement attribuées à Clotilde de Surville.
Limousin

Monsieur de Pourceaugnac selon Molière selon
vient de Limoges ; mais le Limousin a bien changé depuis. Ce pays élevé,
froid, pluvieux, avait longtemps souffert ; si longtemps disputé entre
la France et l'Angleterre, théâtres de guerres continuelles, longtemps
incertain entre les deux partis contraires. De là cette indécision que
raille Molière. Mais ce caractère a disparu avec les causes qui le produisaient,
et la gloire littéraire de cette province n'a rien à envier aux autres.
Le caractère remuant et spirituel des méridionaux est déjà frappant
dans le bas Limousin. Les noms des Ségur, des Sainte-Aulaire, des Noailles,
des Ventadour, et surtout des Turenne, indiquent assez combien les hommes
de ce pays se sont rattachés au pouvoir central, et combien ils y ont
gagné.
C'est au Limousin que nous devons le savant et laborieux
Baluze. A Bort est né Marmontel, l'ingénieux et spirituel conteur, qui,
sans être dans aucun genre un écrivain supérieur, les cultiva presque
tous avec quelque succès ; à Brive, Trailhard, dont le nom est attaché
à la législation qui nous régit ; Charles de Lasteyrie, le savant agronome,
qui consacra son talent à l'instruction des campagnes, et son fils,
le savant auteur de l'Histoire de la peinture ; à Grimont, l'abbé de
Feletz, le spirituel feuilletoniste du Journal des Débats, le critique
fin et ingénieux, dont les articles réunis ont formé un livre aussi
solide qu'intéressant ; à Cosnac, enfin, Cabanis, l'immortel physiologiste,
à qui la philosophie et la religion ont pu reprocher des erreurs d'autant
plus regrettables que son talent et sa puissante conviction les ont
rendues contagieuses, mais qui a enrichi la science d'une foule d'observations
aussi utiles que profondes.
Pour le haut Limousin, les noms de Muret,
de d'Aguesseau, de Vergniaud, sont une éclatante réponse aux railleries
de Molière. Si le nom de Muret, le latiniste, semble sortir de notre
cadre, quel pays ne serait fier d'avoir produit le vertueux et intègre
d'Aguesseau, dont l'éloquence, peut-être un peu compassée, a su cependant
trouver des accents si vrais et si majestueux pour peindre la majesté
de la vertu et enseigner aux magistrats leurs devoirs ? Et Vergniaud,
l'entrainant orateur, le chef brillant de la Gironde, dont la poétique
et sublime éloquence suffirait pour faire la gloire d'une grande assemblée,
et qui peut-être aurait égalé le plus brand orateur des temps modernes,
Mirabeau, sans son indifférence pour la gloire, et si les fureurs révolutionnaires
lui en avaient laissé le temps ? Citons encore un nom contemporain,
l'habile et savant économiste Michel Chevalier, l'un des chefs de l'école
moderne, l'un des plus ardents et des plus puissants promoteurs de la
liberté des échanges et du commerce.
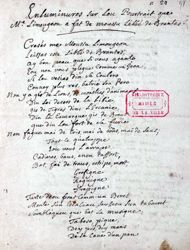
Périgord, Guyenne, Gascogne, Béarn, Bigorre, Rouergue, Roussillon
Nos provinces du sud-ouest, assimilées entre
elles par le climat et la position, par la langue et l'accent, longtemps
unies sous la domination des Wisigoths, des ducs d'Aquitaine, des Anglais,
ne peuvent être séparées, et les différences qui les distinguent ne
sont que des nuances qu'il serait difficile de faire sentir sans entrer
dans de longs et minutieux détails. Peuple léger et charmant, plein
de vivacité, d'esprit, d'imagination, touchant à tout sans approfondir;
religieux ou incrédule par caprice, par occasion; consacrant la finesse
et la subtilité de son esprit à la conduite et aux succès dans le monde;
unissant à la vivacité et aux élans des peuples méridionaux la gaieté
et le bon sens de l'esprit français; terrible parfois et emporté dans
ses passions, mais bientôt calmé; il semble qu'après avoir passé sous
tant de maîtres différents sans avoir le temps d'en recevoir une empreinte
durable, il n'en ait retenu que l'inconstance.
« La Guyenne, le
pays de Montaigne et de Montesquieu, est celui des croyances flottantes.
Fénelon, l'homme le plus religieux qu'ils aient eu, est presque un hérétique.
C'est bien pis en avançant vers la Gascogne, pays de pauvres diables,
très nobles et très gueux, qui tous auraient dit comme leur Henri IV
« Paris vaut bien une messe. » En effet, malgré ce qu'un pourrait trouver
peut-être d'exagéré dans le tableau tracé par l'illustre historien (Michelet),
la plus haute personnification de ce génie hardi, rapide, léger, paraît
être Montaigne, avec son esprit prime-sautier, si vif et si piquant.
Il est douteur par nature, par instinct, par répulsion pour toutes ces
affirmations hardies qui se posent autour de lui. « Ses Essais, dit
Mr. Demogeot, sont le premier et peut-être le meilleur fruit qu'ait
produit en France la philosophie morale. C'est le premier appel adressé
à la société laïque et mondaine sur les graves matières que les savants
de profession avaient jusqu'alors prétendu juger à huis clos. Le principal
charme de cet ouvrage, c'est qu'on y sent à chaque ligne l'homme sous
l'auteur. Ce n'est point un traité, encore moins un discours ; c'est
la libre fantaisie d'un causeur aimable et prodigieusement instruit,
qui se déroule capricieusement sous vos yeux. L'idée y prend un corps,
l'abstraction devient vivante. Le livre et l'écrivain ne sont qu'une
même chose. Montaigne a pour ainsi dire vécu son ouvrage au lieu de
le composer. » Parmi les illustrations du Périgord figure au premier
rang l'archevêque de Cambrai, Fénelon, l'immortel auteur de Télémaque.
Bien que docile à la parole de l'Église, Fénelon est l'apôtre de l'inspiration
intérieure. C'est lui qui proclame qu'il ne faut pas chercher la
lumière au dehors de soi et que chacun la trouve en soi-même. Cette
lumière est commune à tous les hommes, supérieure à eux, elle est parfaite,
immuable, toujours prête à se communiquer en tous lieux et à redresser
tous les esprits qui se trompent. Elle se montre à la fois à tous les
hommes et dans tous les coins de l’univers. C'est dans son livre
des Maximes des saints que Fénelon avait résumé sa doctrine, livre qui
déplut à la fois à la cour de Rome et à Louis XIV. « Un instinct de
despote, ajoute Mr. Demogeot, avertissait ce prince que l'édifice si
régulier, si logique de son pouvoir absolu avait là un ennemi d'autant
plus redoutable qu'il était moins violent. On disait avec raison que
la grande hérésie de l’archevêque de Cambrais était en politique
et non pas en théologie et Louis l’appelais nettement le plus
bel esprit et le plus chimérique de son royaume
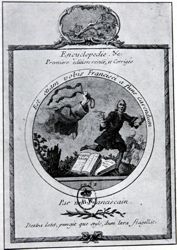
Les chimères de Fénelon devaient être bien dépassées
par les réalités de l'avenir, et c'est un honneur pour lui d'avoir appelé
des réformes qui auraient pu dispenser la France d'une révolution. La
lettre hardie qu'il écrivit au roi, en 1704, sur les abus de son règne
; Les mémoires Particulières qu'il rédigea en 1711 et qui devaient servir
de programme à un règne nouveau, enfin ses admirables Directions pour
la conscience d’un roi rendront sa mémoire éternellement chère à tous
les amis d'une sage liberté. Montesquieu aussi est bien l'enfant de
sa province mais il a subi l'influence de son siècle aussi bien que
de son pays. Il doute des vérités de la religion, mais sans trop s'y
appesantir et sans s'en préoccuper. Son scepticisme se borne là ; partout
ailleurs il est dogmatique et affirmatif, et l'on retrouve en lui le
trait général des grands génies du XVIIIème siècle, la recherche
théorique et formelle de la vérité elle-même, L'abbé Raynal, moins grand
de génie que Montesquieu, a comme lui soif de la vérité. Le doute n'est
pour lui, comme pour toute l'école spiritualiste, qu'un point de départ,
et non pas un but, un doux oreiller, comme pour Montaigne.
Cependant
l'influence du christianisme a laissé dans quelques génies une empreinte
plus profonde. Là est né saint Vincent de Paul, également dévoué à la
religion et à l'humanité, qui puisa dans son cœur ses plus nobles inspirations
pour qui les discours étaient des actes, et qui par-là mérite une place
dans l'histoire littéraire, comme ses travaux apostoliques et ses fondations
pieuses lui assurent un droit immortel à la reconnaissance des peuples.
Frayssinous, dont les conférences religieuses ont fait tant de bruit
dans notre siècle, appartient au Midi, ainsi que cet illustre archevêque
de Paris, Mgr Affre, qui a donné sa vie pour mettre un terme aux luttes
affreuses dont Paris fut ensanglanté pendant plusieurs jours, en juin
1848.
Voilà de bien grands noms ; mais ces contrées si vives, si
poétiques, où l'imagination déborde, devaient produire aussi des littérateurs,
des poètes, des orateurs.
Dès le XIIème et le XIIIème
siècle, nous trouvons les troubadours Bérenger de Palasol, Guillaume
de Cabestan et Bertram de Born, leur contemporain et leur maître, dont
la poésie s'élève avec une impétuosité si violente, quand il peint la
joie terrible des batailles et c’est affreux plaisir de ravager et de
tuer. Plus tard, Clément Marot,
ce poète si naïf et si fin, si gracieux et si mordant, qui fit école
en France, et aujourd'hui même encore a des imitateurs. Né à Cahors
en 1195, « cet aimable poète, dit encore Mr. Demogeot, absorbe et résume
en lui sous une forme plus pure toutes les qualités de notre vieille
poésie ; il en possède tous les charmes, mais il en a aussi toutes les
limites. On retrouve en lui la couleur de Villon, le naturel de Froissart,
la délicatesse de Charles d'Orléans, le bon sens d'Alain Chartier et
la verve mordante de Jean de Meung. Tout cela est rapproché, concentré
dans une originalité piquante et réuni par un don précieux qui forme
comme le fond de cette broderie brillante d'esprit. Marot est le premier
type véritable de l'esprit français dans son acception la plus restreinte,
mais la plus distinctive. Il semble que la poésie du XIVème
et du XVème siècle, sur le point de s'éclipser devant l'éclat
nouveau de la Renaissance, ait ramassé toutes les richesses pour en
douer cet heureux héritier des trouvères. »

Théophile de Viau, plus critiqué que connu, qui
doit à son siècle des travers incroyables, et il lui-même des traits
de poésie souvent admirables ; Dubartas, plein de verve, d'imagination,
quelquefois de grandeur, mais dont le goût n'égalait pas le génie ;
c'est lui qui, dans un vers, appelait le soleil grand lac des chandelles;
Le Franc de Pompignan, qui par sa vanité s'attira les railleries de
Voltaire, mais dont il reste quelques strophes pleines de poésie et
de grandeur; et, enfin, Berduin, ce nom si cher à l'enfance, sont aussi
des hommes de ces contrées.
Parmi les prosateurs, nous trouvons
Brantôme, le continuateur de Froissart, comme lui plein de vie et de
mouvement, comme lui naïf et toujours intéressant, qui sait si bien
s'emparer de ses lecteurs et les reporter aux scènes qu'il décrit, mais
dont l'imagination quelquefois déréglée se laisse emporter à des tableaux
qui n'ont pas pour excuse, comme ceux de Juvénal, l'indignation du narrateur
Henri IV, dont la correspondance est si remarquable ; Cyrano de Bergerac,
qui fit l'histoire comique du soleil et de la lune, ouvrages singuliers,
mais souvent pleins de verve, et qui dans son Pédant joué a imaginé
une situation et une scène que Molière, prenant, dit-il, son bien où
il le trouvait, a pu transporter dans une de ses comédies; De La Calprenède,
auteur de Cléopatre et de Cassandre, romans qui excitaient l'enthousiasme
de Madame de Sévigné, et dont la longueur seule explique l'oubli où
ils sont tombés ; Garat, écrivain de talent, qui a tout fait pour la
gloire de ceux qu'il a loués ; Guibert, qui écrivit des tragédies et
publia des ouvrages sur divers sujets militaires, dont la netteté, la
précision mérita les éloges et excita l'admiration de Voltaire. N'oublions
pas Madame Cottin, dont les romans sont remplis d'un intérêt si saisissant,
et qui sut peindre avec tant de vérité les passions du cœur humain;
ni ces deux poètes si complètement méridionaux, si exclusivement inspirés
par leur pays, qui tous deux ont eu le tort d'écrire dans une langue
connue seulement dans quelques provinces, que personne n'apprend, et
dont le destin a été si divers, que l'un a trouvé la gloire dans la
cause même qui a condamné l'autre à l'obscurité et à l'oubli Goudoulin
et Jasmin. Ici trouve sa place cette immortelle Gironde, qui lutta si
vaillamment contre les montagnards, dans la Convention Fonfrède, Guadet,
Gensonné, tous jeunes et éloquents, tous unis dans la vie et dans la
mort, et qui périrent rassasiés de triomphes et de gloire à cet âge
où la plupart des génies s'ignorent encore ; et leurs dignes successeurs,
Lainé, un grand caractère qui osa résister à Napoléon Ier,
et le général Lamarque, une des plus pures gloires militaires et oratoires
de notre siècle. Voilà déjà une bien longue liste, et que de noms encore
qu'on ne peut cependant pas passer sous silence ! Tous les écrivains
que nous avons énumérés représentent tous un côté littéraire et poétique
de l'imagination méridionale. Voyons ce qu'a produit la finesse d'esprit
et la pénétration des hommes de ces provinces, appliquées aux sujets
philosophiques ou scientifiques.

Tels sont le cardinal d'Ossat, l'illustre diplomate ; La Boétie, qui fit à vingt ans un ouvrage immortel par la vigueur du style et la hardiesse de la pensée. Maine de Biran, l'éminent philosophe, le plus prudent métaphysicien de son siècle ; La Romiguière, qui exposa et développa le système de Condillac avec tant de mesure, et honora par son talent comme par son caractère les convictions généreuses auxquelles il était resté fidèle ; Lacépède, l'ami et l'héritier de Buffon, qui le choisit pour continuer et compléter son œuvre.; Bastiat, l'économiste profond, qui sut être clair en des sujets abstraits et arides; l'illustre Arago, qui plus que tout autre eut la gloire de rendre les sciences populaires et de mettre à la portée de tous une des études les plus ardues et les plus effrayantes pour l'imagination de l'homme, et qui, à toutes ces qualités, joignait celles de grand écrivain et d'habile orateur, et, enfin, Léon Gambetta, l'éloquent tribun de la troisième République.
Languedoc
« C'est une bien vieille terre que ce Languedoc.
Vous y trouverez partout les ruines sous les ruines, les Camisards sur
les Albigeois, les Sarrasins sur les Goths sous ceux-ci, les Romains,
les Ibères. Les murs de Narbonne sont bâtis de tombeaux, de statues,
d'inscriptions. L'amphithéâtre de Nîmes est percé d'embrasures gothiques,
couronnées de créneaux sarrasins, noircis par les flammes de Charles-Martel.
Mais ce sont encore les plus vieux qui ont le plus laissé les Romains
ont enfoncé la plus profonde trace leur Maison-Carrée, leur triple pont
du Gard, leur énorme canal de Narbonne, qui recevait les plus grands
vaisseaux. » Tel est, en quelques mots, suivant Michelet, le portrait
du vieux Languedoc.
Grâce à ces vieilles habitudes de liberté municipale,
cette province a longtemps échappé à la féodalité. Ce n'est qu'à la
suite des guerres des Albigeois, à la faveur de la religion, qu'elle
put s'y introduire avec Simon de Montfort. Amoureux de liberté politique
et soumis au clergé, plus fanatique cependant que dévot, ce pays a toujours
été un foyer d'opposition. Le catholicisme même s'y est transformé en
jansénisme, et plus d'une hérésie s'y est produite depuis Félix d'Urgel
et Vigilance jusqu'aux Albigeois. C'est là qu'est né Bayle, le sceptique
par excellence, qui douta de tout, et fit de son doute une doctrine,
une croyance. C'est un fort et dur génie que celui du Languedoc. Là,
les convictions sont violentes, l'incrédulité intolérante, et par là
il se distingue profondément de la légèreté spirituelle de la Guyenne
et de la pétulance emportée de la Provence. Le trait commun cependant,
cette vive et poétique imagination du Midi, se retrouve dans ses poètes.
C'est à lui que nous devons, dans les premiers siècles de notre
littérature, Périgon, Raymond du Bousquet, Clémence Isaure, qui fonda
ou du moins rétablit à Toulouse les Jeux floraux.
Dans les temps
plus modernes, il a produit La Fare, le cardinal de Bernis, qui eut
plus de succès. dans la littérature que dans le ministère ; Pibrac dont
les quatrains ont été traduits même en grec; les Chénier, tous deux
également célèbres, mais à des titres différents l'un, André, le poète
de La jeune captive, qui renouvela parmi nous l'entreprise de Ronsard,
mais avec plus de goût et de jugement ; qui, nourri du génie grec, voulut
l'introduire dans la poésie française, et dont les œuvres marquèrent
une ère de rénovation du génie poétique de la France l'autre, Marie-Joseph,
l'auteur de Charles IX et du Chant du Départ moins original peut-être,
mais plus véhément, plus emporté, satirique mordant, fit des tragédies
politiques, souvent étincelantes de verve et d'énergie, et qui, bien
que jetées dans le moule des tragédies de l'époque, s'en distinguent
par le mouvement et la vigueur des pensées.

Nous devons citer encore Campistron, l'élève
et l'imitateur de Racine, bien inférieur à son modèle, mais non pas
sans mérite ; Fabre d'Églantine, l'auteur du Philinte de Molière, génie
incomplet, mais à qui on ne peut refuser la vivacité et l'énergie Florian,
l'aimable auteur d'Estelle et Némorin et le plus digne successeur de
La Fontaine comme fabuliste, si La Fontaine pouvait avoir des successeurs
; Brueys et Palaprat, qui remirent au théâtre la vieille farce de Patelin
et que la postérité a laissés unis comme ils l’avaient été dans leur
vie Roucher, le poète des Mois et le compagnon d'André Chénier sur l'échafaud
; Baour-Lormian, le poétique traducteur d'Ossian et le premier, parmi
les pseudo-classiques, qui tira le canon d’alarme contre l'école romantique
; Viennet, homme politique et poète, à la verve si mordante et si libre
; Alexandre Soumet, à qui son élégie de la Pauvre Fille suffirait pour
assurer sa part de célébrité ; Guiraud, l'auteur des Elégies Savoyardes,
et enfin Victorin et Auguste Fabre, tous deux poètes et prosateurs distingués.
Parmi les prosateurs, nous trouvons Rapin-Thoyras, neveu de Pellisson,
auteur d'une Histoire de l’Angleterre encore estimée Cujas, une des
lumières de la jurisprudence ; Rivarol, le caustique et spirituel écrivain
; Ricard, le savant traducteur de Plutarque ; Court de Gébelin, dont
l'érudition embrassa tous les sujets et qui voulut apprendre, de l'esprit
humain, l'histoire de ses premiers développements ; Las Cases, à qui
nous devons l’ histoire des pensées de Napoléon ler Daru,
poète et historien, et enfin Frédéric Soulié, dont la sombre imagination
nous a retracé avec tant de vérité, dans ses romans, les principales
scènes de la terrible histoire de son pays.
L'éloquence a eu, là
aussi, ses représentants Pellisson, le noble et courageux défenseur
de Fouquet disgracié ; l'éloquent Bridaine Cazalès, l'ardent défenseur
de la royauté à l'Assemblée constituante Lakanal, l'organisateur de
l'instruction publique sous la Convention, Guizot, un des hommes d'État
de la monarchie de 1830, en même temps que l'un de nos plus éminents
historiens, dans un siècle qui en a tant produit.
Provence
Il y a un rapport singulier entre la nature, le climat de la Provence et le génie de ses habitants. Ces marais qui la bordent, ces orages violents et subits qui changent les plaines en lacs et les entraînent dans le Rhône, ce vent éternel et glacial sous un soleil de feu, tous ces caprices d'une nature violente, passionnée et pourtant charmante représentent, par une vive image, les continuels et rapides changements de ce génie emporté et cependant plein de grâce.

Ce pays, peuplé de cités grecques et de municipes
romains, en a conservé un singulier esprit de liberté, et dès les premiers
siècles nous en voyons les manifestations. Quand la voix de Pélage s'éleva
pour proclamer l'indépendance de la raison humaine, Faustus, Cassien
répondirent à son appel, et ces doctrines furent celles de l'illustre
école de Lérins. Quand Descartes dégagea la philosophie des entraves
théologiques, Gassendi tenta la même révolution au nom du sensualisme
et, au XVIIIème siècle, nous retrouvons encore un Provençal,
le marquis d'Argens, à côté de Maupertuis et de Lamettrie. « Ce n'est
pas sans raison que la littérature du Midi, au XII et au XIIIème
siècle, s'appela la littérature provençale. On vit alors tout ce qu'il
y a de gracieux et de subtil dans le génie de cette contrée. C'est le
pays des beaux parleurs, abondants, passionnés au moins pour la parole
et, quand ils veulent, artisans obstinés de langage ils ont donné Massillon,
Mascaron, Fléchier, Maury, les orateurs et les rhéteurs. Mais la Provence
entière, municipes, parlement et noblesse, démagogie et rhétorique,
le tout couronné d'une magnifique insolence méridionale, s'est rencontré
dans Mirabeau, le cou du taureau, la force du Rhône. »
Sans vouloir
établir de comparaison, nommons après lui l'abbé Poulle, prédicateur
remarquable ; Manuel, le député patriote, dont le nom rappelle un des
plus tristes scandales politiques de la Restauration, et Berryer, le
grand orateur de la légitimité. On peut dire, en général, que le caractère
provençal ressemble plus à celui de la Gascogne qu'à celui du Languedoc,
qui l'avoisine. Le génie plus profond et plus concentré du Languedoc
s'éloigne également de la vivacité enjouée des Gascons et de la pétulance
du Provençal. Dans cette dernière province, les écrivains sont plus
vifs et plus colorés, et l'accent musical y' est plus marqué. Les poètes
Esmenard, Barthélemy, Méry, Joseph Autran, l'auteur des Poèmes de la
Mer, Jean Aycard, Henri de Bornier, l'auteur des Noces d'Attila ; François
Coppée, le charmant poète du Passant, ont pour caractère commun l'amour
du rythme et de la forme. Désaugiers, moins élevé que Béranger, dans
son talent quelque chose de plus insouciant, de plus libre ; c'est en
lui que se personnifie cette gaieté si vive, si spirituelle du Midi
mais, chez lui, comme chez tous les peuples de cette contrée, l'imagination
et l'esprit jouent un plus grand rôle que le sentiment. Il y a cependant
un poète qui fait exception à cette règle, c'est Reboul, le boulanger
de Nîmes, qu'on pourrait comparer par certains côtés avec notre immortel
Lamartine. Chez lui, la délicatesse du sentiment s'unit à la vivacité
de l'imagination.
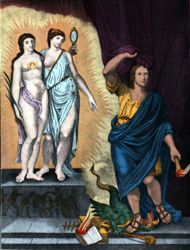
Nous ne devons pas oublier la pléiade des félibres,
à la tête desquels marchent Mistral, le chantre inspiré de Mireille
; Roumanille, Félix Gras, etc., qui se sont donné pour mission de faire
revivre la langue des troubadours provençaux.
Cette puissance de
l'imagination, en s'unissant à la subtilité et à la finesse du génie
provençal, a formé des historiens qui ont à la fois le talent de tout
pénétrer et celui de tout représenter par vives Photos. Sans parler
de Moréri, qui fut plutôt un savant compilateur qu'un historien, ces
qualités, déjà très sensibles chez l'abbé Barthélemy et Raynouard, s'élèvent
au plus haut degré dans les œuvres des historiens contemporains, MM.
Thiers et Mignet, si clairs tous deux parce qu'ils voient bien, si saisissants
parce qu'ils parlent à notre imagination aussi bien qu'à notre intelligence.
Cependant chacun d'eux possède ces deux qualités à des degrés différents
on pourrait dire peut-être que chez l'un la pénétration est le caractère
dominant, chez l'autre le talent d'exposer et de peindre. Ayant à retracer
le grand drame révolutionnaire et 1'héroïque épopée du Consulat et de
l'Empire, M. Thiers a su particulièrement s'approprier et mettre en
œuvre les souvenirs des acteurs encore vivants de cette mémorable époque.
« Vieux débris de la Constituante, de l'Assemblée législative, de la
Convention, du Conseil des Cinq-Cents, du Corps législatif, du Tribunat,
girondins, montagnards, vieux généraux de l'Empire, fournisseurs des
armées révolutionnaires, diplomates, financiers, hommes de plume, hommes
d'épée, hommes de tête, hommes de bras, M. Thiers passait en revue tout
ce qu'il en restait, questionnant l’un, tournant autour de l'autre pour
le faire parler, prêtant l'oreille gauche à celui-ci, l'oreille droite
à celui-là et puis, réunissant, coordonnant dans sa tête tous ces propos
interrompus, il rentrait chez lui, se couchait sur le Moniteur et ajoutait
une page de plus à cette belle Histoire de la Révolution Française,
qui eut un si grand retentissement, et qu'il fit suivre plus tard de
L’Histoire du Consulat et de l’Empire. Cette pénétration, si remarquable
chez Mr Thiers, brille d'un éclat singulier dans les œuvres de d'Urfé.
Là, au milieu de ce fatras romanesque, qui n'est cependant pas toujours
sans grâce ; au milieu de ces descriptions, presque toujours charmantes,
on surprend à chaque page des analyses de sentiment d'une incroyable
finesse. Vauvenargues à cette même pénétration unit une âme sensible
et élevée, un goût sûr, et l'on ne peut prévoir ce qu'eût pu produire
dans une vie plus longue ce génie si pur, si délicat et souvent si profond.
Dans un ordre d'idées différent, le comte de Portalis nous a laissé
un ouvrage qui prouve une sagacité digne des noms que nous venons de
citer, je veux parler de son livre De l'abus de l'esprit philosophique
au XVIIIème siècle. Nous retrouvons encore le même caractère
dans les appréciations littéraires si fines, si délicates de J.-J. Ampère.
D'autres ont porté ces qualités dans d'autres études. Le Marquis de
Pasloret les a appliquées à la jurisprudence ; Adanson, à l'étude de
la nature animée ; Dumarsais, à la grammaire ; et Raspail, avec ses
découvertes chimiques et médicales et ses entraînements politiques,
représente bien cet esprit, à la fois sagace et pétulant, du pays où
il est né.
Dauphiné, Franche-Comté, Lorraine
Ici, nous rencontrons un caractère tout nouveau.
Des provinces que nous avons parcourues, les unes sont défendues par
la mer, les autres par le mur des Pyrénées. Ici, nous entrons dans la
zone militaire de la France. L'ennemi est à deux pas, cela donne à songer,
et d'ailleurs le climat est plus sévère. Ce n'est plus ce riant soleil
qui enflamme l'imagination et les sens. L'esprit critique domine, et,
dans la poésie même, que nous y trouverons encore, parce qu'elle est
inhérente à la nature humaine, nous n'apercevrons guère partout que
le même ordre d'idées sous des formes différentes. Ce ne sera plus la
poésie d'imagination avec ses vifs élans mais le drame, la description,
la satire. Ce caractère est commun sur toute la ligne qui distingue
la France de la Suisse et de l'Allemagne. Aussi ne séparerons-nous pas
le Dauphiné, la Franche-Comté, la Lorraine ; et même nous comprendrons
dans cette, revue certaines parties de la Bourgogne et de la Champagne,
l'Ain et les Ardennes, qui, placés dans la même situation, ont subi
les mêmes influences.
Tous ont eu à lutter sans cesse contre les
ennemis et à repousser les invasions ; chez tous, la nature est rude
et le sol hérissé de montagnes. Aussi le génie de ces populations est-il
partout sévère et opiniâtre. A cela s'ajoutent les austères doctrines
du calvinisme, au moins pour le Dauphiné. Dans le seul département de
la Drôme, on compte environ trente-quatre mille calvinistes, et c'est
là que s'est livrée la terrible, et longue bataille du baron des Adrets,
de Montbrun et de Lesdiguières contre les catholiques.
Grâce à ces
influences, ces contrées ont donné à la science des esprits sévères
et analytiques. Mably et Condillac sont de Grenoble ; d'Alembert est
Dauphinois par sa mère ; de Bourg-en-Bresse sont l'astronome Lalande
et Bichat, le grand anatomiste.

Les hommes éminents de ces contrées sont des
économistes, des philosophes, des savants, des grammairiens, des critiques.
Les philologues sont nombreux dans ce pays ; ce sont Beauzée, l'abbé
d'Olivet, Charles Nodier, qui, aux qualités brillantes de la plus vive
imagination, joignit la sagacité du grammairien. La critique littéraire
est représentée par l'abbé de La Porte, le continuateur de Fréron ;
Palissot, qui fit des comédies et des satires, et est surtout connu
par sa lutte contre les encyclopédistes ; Suard, le journaliste, littérateur
et critique spirituel, dont le titre principal est le recueil des lettres
où, sous le pseudonyme de l’anonyme de Veaugirad, il défend la musique
allemande contre la musique italienne ; l'histoire, par dom Calmet,
Maimbourg, le cardinal Granville, le grand diplomate qui a laissé de
si précieux mémoires ; Chorier, l'historien du Dauphiné ; l'abbé Millot
; le père Mailla, le traducteur des grandes annales de la Chine ; de
Genoude, qui, tout en consacrant sa vie à la politique, a trouvé le
temps de traduire la Bible et d'écrire vingt-trois volumes sur l'histoire
de France ; et enfin Michelet, notre éminent historien, qui, bien que
né à Paris, appartient par sa famille au département des Ardennes. Cet
honneur est trop précieux pour que nous ne le rendions pas à cette province.
De tous les historiens, peintres ou philosophes, Michelet est certainement
le plus hardi et le plus brillant. L'histoire, entre ses mains, n'est
plus une narration, c'est,' comme il l'a dit lui-même, c’est une résurrection.
A la rois poète et historien, il trouvé le secret de nous faire contempler
tous ces personnages de l'histoire comme s'ils vivaient sous nos yeux.
Le temps n'existe plus Jeanne d’Arc, Louis XI, Charles le Téméraire
sont là, tissant, et nous suivons d'un regard avide chacun de leurs
mouvements. L'économie politique présente les noms de Blanqui et de
Proudhon, tous deux diversement célèbres. Fourier aussi est né à Besançon.
Au milieu de ses erreurs, on rencontre cependant des vues profondes,
et ses adversaires mêmes ne peuvent méconnaître en lui un ardent amour
de l'humanité et le désir sincère de lui être utile. Les philosophes
Droz et Jouffroy sont du même pays. Jouffroy, cette âme mélancolique
et profonde, d'une grandeur si simple, d'une si touchante poésie. A
ces noms s'ajoute celui de Louise Serment, le philosophe de Grenoble.
Parmi les théologiens, nous remarquons Guillaume Saint-Amour, l'adversaire
du mysticisme des ordres mendiants ; Gerson, chez qui le mysticisme
chrétien n'amollit pas 1'énergie dans la conduite de la vie ; et enfin,
parmi les naturalistes, Ramond de Carbonnières, l'historien ou comme
1.'appelle Michelet, le poète des Pyrénées et l'immortel Cuvier, dont
le génie perça si profondément les secrets de la nature ; qu'il sembla
en avoir, saisi par une sorte d'intuition le plan tout entier.
Les
orateurs sont, Servan, dont les discours judiciaires et politiques sont
remarquables par leur vigueur, et à qui il n'a manqué qu'un goût plus
pur ; Mounier; Barnave, l'adversaire de Mirabeau ; Casimir Périer, l'orateur
politique et le plus grand homme d'État de la monarchie de Juillet.
La littérature proprement dite est aussi représentée par des noms bien
connus, Mme de Tencin, dans les romans de laquelle on trouve moins peut-être
la vivacité de l'imagination et du sentiment qu'une singulière finesse
d'analyse et d'observation Mme de Graffigny, dont les Lettres péruviennes
sont un tableau souvent saisissant des mœurs de son temps; Brillat-Savarin,
l’ingénieux et piquant physiologiste du goût; Charles de Bernard, dont
les nouvelles et les romans présentent un intérêt toujours soutenu ;
et enfin Charles Nodier, que nous avons déjà eu l'occasion de citer,
et qui eut l'art d'attacher tant de charme aux sujets les plus légers.
Les poètes eux-mêmes retiennent une forte part de cet esprit critique
et sévère. Leurs caractères sont la finesse, la netteté, l'énergie,
la délicatesse, l'analyse savante, plutôt que l'imagination, qui entraîne
et enlève. Les uns se sont voués au théâtre, comme Mairet, Campenon,
Guilbert de Pixérécourt, Casimir Bonjour, Andrieux, Émile Augier ou
à la satire, comme Gilbert; ou au genre descriptif, comme Saint-Lambert
; ou à l'élégie, comme Mme Desbordes-Valmore et Tastu; ou à la poésie
légère, comme Boufflers. Quelques-uns, comme François de Neufchâteau,
ont essayé leurs talents sur des sujets plus variés ; mais dans aucun
l'imagination n'est la qualité dominante. Et cependant, parmi ces noms,
plus d'un est entouré d'une gloire justement méritée. Un seul nom imposant
pourrait nous être cité, celui de
Victor Hugo ; mais le hasard seul le fit naître à Besançon, où il
ne resta que peu de jours. Son père était Lorrain, sa mère Vendéenne.
Après avoir passé une partie de son enfance en Espagne, il revint à
Paris.

C'est la combinaison de toutes ces influences
qui a fait le caractère si multiple de son génie, et sa naissance à
Besançon ne pouvait guerre influer sur sa destinée. Nul poète n'a plus
subi les influences de son temps. Royaliste et religieux sous la Restauration,
libéral en 1830, républicain socialiste en 1848 et 1870, il a chanté
toutes les causes et pour tous les partis, et marqué toutes ses étapes
par des chefs-d'œuvre. Il est le chef de cette nouvelle école littéraire
qui, sous le nom de romantisme, a prétendu réformer la langue française
et le théâtre et qui n'a produit encore, sauf dans la poésie lyrique,
que des fruits imparfaits ou exagérés. Victor Hugo n'en reste pas moins
un grand magicien en fait de style, et son nom planera sur le XIXème
siècle comme celui de Ronsard, le chef poétique de la Renaissance, sur
celui de François 1er .
C'est également de la Franche-Comté
qu'est sorti l'auteur de ce chant immortel qui conduisit si longtemps
nos armées à la victoire, La Marseillaise,
tout enflammée de patriotisme et d'amour de la liberté Rouget de l'Isle
était de Lons-le-Saunier.
Lyonnais
Derrière cette rude et héroïque zone de Dauphiné, Franche-Comté, Lorraine, Ardennes, dit Michelet, s'en développe une autre tout autrement douce et plus féconde des fruits de la pensée. Je parle des provinces du Lyonnais, de la Bourgogne et de la Champagne. Zone vineuse, de poésie inspirée, d'éloquence, d'élégante et ingénieuse littérature. Ceux-ci n'avaient pas, comme les autres, à recevoir et à renvoyer sans cesse le choc de l'invasion étrangère. Ils ont pu, mieux abrités, cultiver à loisir la fleur délicate de la civilisation. D'abord, tout près du Dauphiné, la grande et aimable ville de Lyon, avec son génie éminemment sociable, unissant les peuples comme les fleuves. Cette pointe du Rhône et de la Saône semble avoir été toujours un lieu sacré. La fameuse table de bronze où on lit encore le discours de Claude pour l'admission des Gaulois dans le Sénat est la première de nos antiquités nationales, le signe de notre initiation dans le monde civilisé. Une autre initiation bien plus sainte a son monument dans les catacombes de Saint-Irénée, dans la crypte de Saint Pothin, dans Fourvière, la montagne des pèlerins. Dans les terribles bouleversements des premiers siècles du moyen âge, cette grande ville ecclésiastique ouvrit son sein à une foule de fugitifs et se peupla de la population générale à peu près comme Constantinople concentra peu à peu en elle tout l'empire grec, qui reculait devant les Arabes ou les Turcs. Cette population n'avait ni champs ni terres, rien que ses bras et son Rhône ; elle fut industrielle et commerçante. Cette fourmilière laborieuse, enfermée entre les rochers et la rivière, entassée dans les rues sombres qui y descendent, sous la pluie et le brouillard, eut sa vie morale pourtant et sa poésie. Son inspiration poétique fut l'amour. Plus d'une jeune marchande, pensive dans le demi-jour de l'arrière-boutique, écrivit, comme Louise Labbé, comme Pernette Guillet, des vers pleins de tristesse et de passion, qui n'étaient pas pour leurs époux. L'amour de Dieu, il faut le dire, et le plus doux mysticisme, fut encore un caractère lyonnais. L'Eglise de Lyon fut fondée par l'homme du désir, saint Pothin ; et c'est à Lyon que, dans les derniers temps, saint Martin, l'homme du désir, établit son école.

Notre Ballanche y est né. L'auteur de l'Imitation, Jean Gerson, voulut y mourir. C'est une chose bizarre et contradictoire en apparence que le mysticisme ait aimé à naître dans ces grandes cités industrielles et corrompues, comme aujourd'hui Lyon et Strasbourg. C'est que nulle part le cœur de l'homme n'a plus besoin du ciel.Là où les voluptés grossières sont à portée, la nausée vient bientôt. La vie sédentaire de l'artisan assis à son métier favorise cette fermentation intérieure de l'âme. L'ouvrier en soie dans l'humide obscurité des rues de Lyon, le tisserand d'Artois et de Flandre, dans la cave où il vivait, se créèrent un monde au défaut du monde, un paradis moral de doux songes et de visions ; en dédommagement de la nature lui leur manquait, ils se donnèrent à Dieu. Le génie de Lyon est plus moral, plus sentimental du moins que celui de la Provence ; cette ville appartient déjà au Nord. » Outre les noms que nous avons déjà cités, le Lyonnais a encore produit l'avocat Bergasse, Camille Jordan, Lemontey, tous deux également célèbres par leur éloquence et leur inviolable attachement aux idées libérales et au dogme de la liberté des cultes; Roland, l'intègre ministre de la Révolution ; Brossette, l'ami et l'éditeur de Boileau ; Boucharlat, mathématicien et littérateur ; le comte d'Albon, le disciple de l'ami des hommes et le panégyriste de Quesnay; le savant et profond économiste J.-B. Say, l'abbé Terrasson, l'auteur de Setos ; André-Martin Ampère mathématicien et philosophe ; l'abbé Morellet, homme et écrivain estimable, dont les mémoires sont si précieux pour l'étude du XVIIIème siècle; de Gérando, le philosophe, qui, ainsi que presque tous les écrivains que nous venons de nommer, se distingua par un profond amour des hommes ; de Rochefort, le traducteur d'Homère et de Sophocle; Antoine de Jussieu, le savant naturaliste, dont le génie se perpétua dans sa famille, et qui commença cette longue génération de savants qui devaient réformer la science et fonder la botanique sur des principes nouveaux ; Aimé Martin, poète et littérateur distingué, dont le nom est désormais inséparable de celui de Bernardin de Saint-Pierre ; Vitet, le spirituel et ingénieux académicien et M. de Senancourt, Lyonnais par sa famille, le mélancolique auteur du mélancolique Obermann, ce poème du désespoir.
Bourgogne
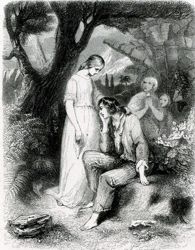
Au nord de Lyon, nous trouvons Autun, la cité
druidique que les Romains dépouillèrent de tout, pour la punir de la
vénération qu'elle inspirait ; mais ils ne purent lui enlever ce génie
austère qui en avait fait le centre de la lugubre religion de nos ancêtres.
Jusqu'aux temps modernes, elle a donné des hommes d'État, des légistes,
le chancelier Raulin ou Rolin, les Montholon, les Jeannis et tant d’autres.
Et cet esprit sévère ne se borne pas dans Autun. Théodore de Bèze, né
à Vézelay, fut l'orateur du calvinisme, le verbe de
Jean Calvin. Mais la gaie et
vineuse Bourgogne ne ressemble en rien à ce triste et désolé pays du
Morvan. La Bourgogne est le pays des orateurs, celui de la pompeuse
et solennelle éloquence. C'est de la partie la plus élevée de la province,
de celle qui verse la Seine, de Dijon, de Montbard que sont parties
les voix les plus retentissantes de la France, celles de saint Bernard,
de Bossuet et de Buffon.
Mais l'aimable sentimentalité de la Bourgogne
est remarquable sur d'autres points, avec plus de grâce au nord, plus
d'éclat au midi vers Semur ; la bonne Mme de Chantal et sa petite-fille
de Sévigné à Macon, Lamartine, le poète de l'âme religieuse et solitaire
; à Charolles, Edgar Quinet, celui de l'histoire et de l'humanité. Il
ne faut pas oublier non plus la pittoresque et mystique petite ville
de Paray-le-Monial, où naquit la dévotion du Sacré-Cœur, où mourut Mme
de Chantal. Il y a certainement un souffle religieux sur le pays du
traducteur de la Symbolique et de l'auteur de la Solitude, MM. Gugniaut
et Dargaud.
La Bourgogne est aussi la patrie du grand orateur religieux
de notre siècle, le P. Lacordaire. Mais, si ce pays est celui de la
grande éloquence, il est aussi celui de l'esprit et de la gaieté. Armand
Gouffé, Radais, les gais chansonniers ; Bernard de La Monnoye, conteur
charmant, auteur des Noëls Bourguignons et en même temps savant distingué
; Papillon, contemporain et rival de Marot ; Piron, le fécond et spirituel
épigrammatiste et l'auteur inspiré de la Métromanie, tous appartiennent
à la Bourgogne, ainsi que les poètes Longepierre, Briffaut ; Boursault,
l'auteur d'Ésope à la cour et à la ville, et Crébillon, le terrible
tragique.

C'est encore là que sont nés Mme de Genlis, dont les nombreux écrits ne lassent pas l'intérêt ; Rétif de La Bretonne, le romancier si étrange, si effréné ; et Clément l'inclément, comme l'appelait Voltaire, et Berchoux, l'aimable chantre de la gastronomie. Du reste, dans cette province, l'imagination et la poésie n'ôtent rien à la solidité de l'esprit ; et si la Bourgogne peut opposer avec orgueil ses poètes et ses orateurs à toute comparaison, elle n'a pas moins de savants Clémencet, l'auteur de l’Art de Vérifier les Dates ; l'érudit et judicieux Bouhier ; Larcher, le savant helléniste et l'habile traducteur ; Saumaise, le prince des commentateurs, dont le nom est devenu synonyme d'érudit ; Sainte Palaye, l'historien de la chevalerie; Vauban, l'immortel ingénieur et le profond économiste, Daubenton, le collaborateur et l'ami de Buffon; et enfin Buffon lui-même, qui, au génie scientifique et à une vaste érudition, joignit une imagination si riche et une éloquence si splendide, l'éternel désespoir des historiens de la nature.
La Champagne
La Champagne est un pays triste, tout couvert de plaines basses et crayeuses ; quelques parties même en sont presque désertes. Les villes sont, en général, laides et mal bâties. Ce pays, au moyen âge, fut singulièrement démocratique et antiféodal. La coutume de Troyes, en établissant l'égalité des partages, détruisit vite la féodalité. Celle-ci crut se recruter et se relever en s'alliant à de riches roturiers; mais elle eut beau déclarer que le ventre anoblit, ceux qui n'avaient pas d'autres titres étaient bien près de la roture, et la morgue nobiliaire le leur fit bien sentir. Alors ils s'éloignèrent de la classe qui les rejetait et se firent bravement marchands. « Cette grotesque transformation de chevaliers en boutiquiers ne dut pas peu contribuer à égayer l'esprit champenois et à lui donner ce ton ironique de niaiserie maligne qu'on appelle, je ne sais pourquoi, naïveté dans nos fabliaux. » D'ailleurs, ces nobles marchands, méprisés de leurs orgueilleux pairs, s'en vengèrent par des satires et de l'esprit. « Ce fut le pays des bons contes, des facétieux récits sur le noble chevalier, sur l'honnête et débonnaire mari, sur Mr. le curé et sa servante. Le génie narratif qui domine en Champagne, en Flandre s'étend en longs poèmes, en belles histoires.
La liste de nos poètes romanciers s'ouvre par
Chrestien de Troyes et Guyot de Provins. Les grands seigneurs du pays
écrivirent eux-mêmes leurs gestes ; Villehardouin, Joinville et le cardinal
de Retz nous ont conté eux-mêmes les croisades et la Fronde. L'histoire
et la satire sont la vocation de la province. Pendant que le comte Thibaut
faisait peindre ses poésies sur les murailles de son palais de Provins,
au milieu des roses orientales, les épiciers de Troyes griffonnaient
sur leurs comptoirs les histoires allégoriques et satiriques de Renard
et Isengrin. Le plus piquant pamphlet de la langue est dû en grande
partie à des procureurs de Troyes, Passerat et Pithou c'est la Satire
Menippée. »
La Champagne a encore produit bien d'autres écrivains.
Eustache Deschamps, le prédécesseur de
La Fontaine, qui lui a emprunté
quelques sujets ; Chrestien Deschamps, qui fit quelques tragédies fort
remarquables pour son temps ; le père Lemoine, qui chanta saint Louis,
et dont le poème renferme de beaux passages pleins de verve et de émotivement
; La Fontaine, le plus original et le plus inimitable des poètes ; sentiment,
esprit, gaieté, naïveté, imagination, tout s'y trouve, même le sublime.
Le moi est haïssable, dit Pascal, La Fontaine eut le talent de le faire
trouver aimable, et, dans ses poésies, c'est surtout lui qu'on aime.
« C'est en lui, dit M. Demogeot, que se réalise de la façon la plus
complète la fusion de tous les éléments du passé au sein d'une pensée
toute moderne et douée de l'originalité la plus puissante. Seizième
siècle, moyen âge, antiquité classique, tout ce qu'il y a de plus heureux,
de plus aimable, de plus élégant dans les poètes d'autrefois, vient
se reproduire sans effort et se résumer avec charme dans ses naïfs et
immortels écrits. Le bonhomme renoue, sans y songer, la chaîne de la
tradition française qu'avait rompue la brillante, mais dédaigneuse littérature
du XVIIème siècle. Bien plus, il semble pressentir et devancer
une philosophie encore inconnue. Tandis que la poésie de son époque,
toute cartésienne d'inspiration, toute mondaine, toute sociale d'habitudes,
ne voit dans l'univers que l'homme moral et considère la nature comme
un mécanisme inanimé, La Fontaine sympathise avec toute la création
tout ce qui vit, tout ce qui végète, l'arbre, l'oiseau, la fleur des
champs, a pour lui un sentiment, un langage » c'est, en un mot, le poète
de la vie universelle.
Roger, dont les comédies se distinguent par
des caractères bien tracés, un esprit fin, un style élégant Étienne,
publiciste et poète, l'auteur des Deux Gendres et de tant d'autres pièces
si habilement conduites et écrites avec beaucoup d'esprit et de délicatesse,
complètent la liste des poètes champenois.
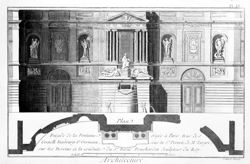
Là aussi est né le fougueux Diderot, l'esprit le plus patient et le plus enthousiaste à la fois du XVIIIème siècle, si bien apprécié également par Mr. Demogeot. « Artiste et savant, sceptique et passionné, élevé et immoral tour à tour, fanfaron d'athéisme, entrainé vers la foi par toutes les puissances de son âme ; aimant partout la vie, la beauté, la nature, tous les rayons dont il prétendait nier le foyer divin, lui seul pouvait, par le singulier assemblage de ses défauts et de ses qualités, être le centre et l'âme de la phalange hétérogène des encyclopédistes. Bizarre et généreuse nature, intelligence trop grande pour n'être pas incomplète, prodigue de ses idées et de ses travaux, insoucieux de sa gloire future, il a rempli de ses pages brûlantes tous les ouvrages, de ses amis, et a laissé à peine sous son propre nom un ouvrage durable. » Ainsi que la poésie et la philosophie, l'éloquence a ses représentants en Champagne : Tronson du Coudray, Linguet et Danton, le terrible tribun, le successeur de Mirabeau. La science revendique Pluche, l'auteur du Spectacle de la Nature, le grammairien Richelet ; les historiens Velly et Mabillon, l'infatigable chercheur ; Perrot d'Ablancourt avec ses Belles Infidèles ; Lebatteu, critique judicieux ; Pierre Pithou, savant jurisconsulte en même temps que spirituel écrivain ; Henrion de Pansey, auteur de traités de jurisprudence estimés ; Barbier d'Aucourt, critique sévère et éclairé ; et Royer Collard, cet écrivain dont la pensée fut si nette, le style si ferme, orateur et philosophe éminent.
Flandre et Artois
Le lissage des laines a fait de tout temps de la Flandre et de l'Artois des contrées commerçantes la fertilité de leur sol y a développé l'agriculture ; aussi personne, au moyen âge, n'entendait-il comme ces populations le commerce, l'industrie, l'agriculture, la vie courante du monde ; nul n'a mieux compris le côté positif et réel de l'existence. Toujours actifs, achetant des laines pour revendre des draps, sans cesse en rapport avec des peuples divers, ils ont pris dans ce commerce continu cet esprit de finesse qui brille d'un si vif éclat dans Comines et lui mérita l'honneur d'être le confident et le ministre du roi le plus positif et le plus madré du moyen âge. Et cependant, au milieu de cette vie agitée, tourmentée par le mouvement des affaires, mêlée à toutes ces actions que nous content avec tant de charmes leurs historiens, Froissart et Monstrelet, son continuateur, nous trouvons un singulier penchant au mysticisme. Cette imagination du Nord si sensuelle, si emportée dans cette grasse et molle Flandre, où le sang semble bouillonner avec tant de violence, s'adoucit parfois et se perd en longues et douces rêveries. C'est qu'il y a là deux populations bien distinctes les hommes d'action, les marchands, les artisans, d'un côté ; et de l'autre, ces ouvriers tisserands enfermés dans leurs caves à peine éclairées, solitaires et rêvant un monde inconnu qu'ils ne peuvent connaître. Ce second caractère se fait peu sentir dans la littérature de ces contrées, et il est facile d'en comprendre la raison. Le premier caractère domine, comme il devait dominer, dans la littérature, dans la peinture surtout, où l'on sent mieux que partout ailleurs l'adoration constante de la nature matérielle. Là, la beauté, c'est la réalité. La recherche et l'apothéose de la réalité, il peine idéalisée quelquefois, voilà le trait général de ces écrivains. Histoire, romans, peinture de mœurs, voilà les sujets qu'ils préfèrent.
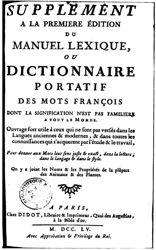
Nous avons déjà cité quelques historiens, et
les plus importants ; il faut y joindre Gaguin de Douai, Oudegherst
de Lille, Baudouin et les empereurs historiens de Constantinople, qui
sortent de la Flandre ; les érudits Baudius et Gasselin; le théologien
Alain les botanistes Matthias de Lobel, Palisot ; le médecin Lecluse
; Merlin de Douai, un des premiers jurisconsultes ; Pigault-Lebrun,
le romancier d'une sensualité trop souvent grossière. Robespierre est
né à Arras ; à Boulogne, Daunou, historien et critique également solide
et judicieux ; à Hesdin, l'abbé Prévost, dont la vie fut si tourmentée
et qui connut si bien les passions humaines, l'auteur de tant de romans,
et surtout de Manon Lescaut, cette analyse du cœur de l'homme, si profonde
et souvent si triste, où ses misères sont dévoilées et mises à nu avec
une vérité qui effrayerait, si chacun ne se flattait d'être à l'abri
de pareils égarements.
L'Artois a fourni plus d'un nom à notre poésie
primitive Audefroy le Bastard, Jean Bodel, Adam de La Halle, sont d'Arras,
mais tous sont des romanciers ou des historiens en vers. L'inspiration
lyrique, l'imagination sentimentale et poétique ne se montrent que dans
deux écrivains contemporains, Mme Marceline Valmore, le poète des larmes,
et Sainte-Beuve, à la fois poète ingénieux et critique délicat.
Normandie
Comme l'a si bien remarqué Michelet, cette avidité, cet esprit sérieux, laborieux, cette intelligence singulière des affaires, qui fait la grandeur de l'Angleterre, c'est de la Normandie qu'elle le tient, et la Normandie n'a pas dégénéré. Nulle province ne peut lutter avec le Normand pour l'esprit processif, pas même les Manceaux, pas même les Dauphinois. Si l’esprit breton, plus négatif et moins absorbant, représente la résistance, le génie de la Normandie, c'est la conquête. Les populations qui l'occupent aujourd'hui ont autrefois presque conquis la France, la partie, du moins qu'ils habitent ils ont conquis l'Angleterre, la Sicile, Naples, et rempli le monde de leurs guerriers et de leur gloire. Aujourd'hui agriculteurs, industriels, ils ont changé d'objet, mais non d'esprit. « Ce génie ambitieux et conquérant se produit d'ordinaire par la ténacité, souvent par l'audace et l'élan ; et l'élan va parfois jusqu'au sublime, témoin tant d'héroïques marins ; témoin le grand Corneille. Deux fois la littérature française a repris l'essor par la Normandie, quand la philosophie se réveillait par la Bretagne. Le vieux poème de Rou parait au XIIèmesiècle avec Abailard ; au XVIIème, Corneille avec Descartes. Aussi est-il impossible de donner tous les noms des écrivains de la Normandie sans tomber dans la nomenclature ; ce serait un détail infini, nous nous contenterons d'indiquer les principaux. Dans nos premiers siècles littéraires Alexandre, l'inventeur du vers alexandrin Wace, l'auteur du Roman de Rou ; Olivier Basselin, foulon de son métier, poète par l'inspiration du cidre, et dont les joyeux couplets ont pris du vallon de Vire qu'il habitait le nom de Vaux de Vire, et par corruption vaudevilles ; Vauquelin de La Fresnaye, le prédécesseur de Boileau ; Alain Chartier
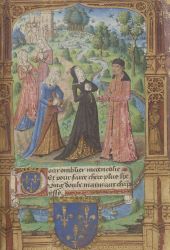
poète et moraliste, souvent éloquent ; Bertaut, disciple et imitateur de Ronsard, mais qui sut éviter ses écarts ; Malherbe, le réformateur de la langue et de la poésie, dont le patient génie créa pour ainsi dire le goût en France l'imposa à la littérature et la força d'entrer dans la voie qui devait aboutir à Corneille et à Racine ; Segrais, l'auteur des idylles louées par Boileau, Thomas Corneille, dont le mérite réel fut éclipsé par la gloire de son frère Benserade, dont le talent est gâté par l'affectation et la recherche ; Chaulieu, le poète spirituel et facile, qui fit les délices de son siècle et fut presque le rival de La Fontaine dans la poésie légère ; Malfilàtre, à qui la mort ne laissa pas le temps de mûrir son talent. De nos jours, la Normandie a produit Castel, le chantre des plantes ; Roisjolin, le poète de la botanique Mr. Ancelot, dont le talent fécond s'est exercé dans les genres les plus variés, vaudeville, drame épopée. Casimir Delavigne le poète des Messeniennes, le dernier et le plus digne représentant de notre littérature classique et dont les compositions théâtrales sont des chefs-d’œuvre d'habileté, de patience d'esprit. Bouilhet, l'auteur de La conjuration d’Amboise. Les prosateurs distingués sont encore en plus grand nombre. Huet, évêque d'Avranches, théologien, philosophe et poète, qui écrivit en grec, en latin, en français, et partout déploya un esprit profond et une immense érudition ; Mézeray, écrivain plein de feu, de mouvement, d'énergie, plus remarquable par les qualités littéraires de son style que par sa science historique ; le comte de Boulainvilliers, le paradoxal et savant panégyriste de la féodalité ; Sarrazin, le rival et le contemporain de Voiture, qui à la finesse et à la légèreté joignit des qualités plus sérieuses ses poésies firent sa gloire à l'hôtel de Rambouillet, mais ses histoires sont des titres plus durables à l'estime de la postérité la bonne et sincère. Mme de Motteville, dont les mémoires ne sont pas seulement précieux pour l'histoire de son temps la lecture en est aussi attachante qu'instructive par un air de sincérité et d'abandon plein de charmes ; Saint Évremont, le successeur de Voiture et le prédécesseur de Voltaire, qui passa la plus grande partie de sa vie en exil, et dont la gloire fut immense. Fontenelle dont l'érudition universelle toucha à tous les sujets ; écrivain fin et voilé, pénétrant et artificiel qui n'ouvre qu'à demi la main où il croit tenir des vérités renfermées ; qui parfois a étendu même sur des sujets sérieux et savamment compris une apparence de frivolité. De là une grâce particulière dans son style, celle des demi-jours. L'affectation la subtilité ne sont qu'à la surface enlevez cette première enveloppe, et vous serez frappé de la solidité et du bon sens ; Dupuis, le savant, mais systématique historien de l'origine des cultes ; Laplace, le grand mathématicien, qui compléta l'œuvre de Newton, répandit plus que tout autre l'intelligence des lois qui régissent 1'univers, et joignit à ses profondes connaissances des qualités littéraires qui lui méritèrent l'honneur d'être admis à l'Académie française ; Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur des Harmonie et des Etudes de la Nature, l'auteur surtout de Paul et Virginie, un des chefs-d'œuvre de notre littérature, chef-d'œuvre de simplicité, de naturel, de sentiment vrai et profond création charmante dit Mr. Demogeot, qu'on admire avec le cœur et qu'on n'applaudit qu'en pleurant. Enfin, de nos jours, c'est encore la Normandie qui a produit le publiciste Armand Carrel ; Alphonse Karr, qui dans ses ouvr,i-es a su si bien unir la fantaisie, l'esprit et le sentiment; Gustave Flaubert, l'auteur de Madame Bovary Au-dessous de ces noms, il y en a bien d'autres encore que nous aurions pu citer Mme de Scudéry, de La Fayette si célèbres par leurs romans au XVIIème siècle ; Louis Leroy, un des auteurs de La Ménippé ; le critique Desfontaines; le bon abbé de Saint-Pierre dont le génie trompa les intentions le père André, le cartésien, quoique jésuite ; Vertot, l'historien, plus intéressant que véridique ; le savant Turnèbe ; le profond orientaliste Eugène Burnouf, aussi philosophe que philologue, et mille autres encore; mais il faut clore cette liste déjà trop longue.
Auvergne
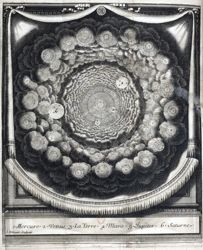
Vaste incendie éteint, aujourd'hui paré presque partout d'une forte et rude végétation. Le noyer pivote sur le basalte, et le blé germe sur la pierre ponce. Les feux intérieurs ne sont pas tellement assoupis que certaine vallée ne fume encore. Villes noires bâties de laves mais la campagne est belle. Pays froid sous un ciel déjà méridional où l'on gèle sur les laves. Il y a une force réelle dans les hommes de cette race, une sève amère, acerbe peut-être, mais vivace comme l'herbe du Cantal. L'âge n'y fait rien. Voyez quelle verdeur dans leurs vieillards, les Delaure, les de Pradt, et ce Montlosier qui, octogénaire, gouvernait ses ouvriers et tout ce qui l'entourait, qui plantait et bâtissait, et qui aurait écrit au besoin un nouveau livre contre le parti prêtre ou pour la féodalité, ami et en même temps ennemi du moyen age. Le génie inconséquent et contradictoire que nous remarquons dans d'autres provinces de notre zone moyenne atteint son apogée dans l'Auvergne. Là se trouvent ces grands légistes ces logiciens du parti gallican, qui ne surent jamais s'ils étaient pour ou contre le pape. Tels furent le chancelier de L'Hospital, le plus grand et le plus digne chancelier qu'il y ait eu en France, dit Brantôme. C'était un autre censeur Caton; il en avait du tout l'apparence avec sa grande barbe blanche, son visage pâle, sa façon grave ; puis les Arnaud, le sévère Domat, Papinien janséniste, qui essaya d'enfermer le droit dans le christianisme, et son ami Pascal le seul homme du XVIIème siècle qui ait senti la crise religieuse entre Montaigne et Voltaire, âme souffrante où apparaît si merveilleusement le combat du doute et de la foi. C'est en auvergne que naquit, en 539, l'un de nos plus anciens historiens, Grégoire de Tours. « Il faut, dit Augustin Thierry, descendre jusqu'au siècle de Froissart pour trouver un narrateur qui égale Grégoire de Tours dans l'art de mettre en scène des personnages et de peindre par le dialogue. Tout ce que la conquête de la Gaule avait mis en regard ou en opposition sur le même sol, les races, les classes, les conditions diverses, figure pêle-mêle dans ses récits, quelquefois plaisants, souvent tragiques, toujours vrais et variés. Nous entrevoyons, à travers sa narration, la manière de vivre des rois francs, l'intérieur de la maison royale, la vie tumultueuse des seigneurs et des évêques de ce temps, la turbulence intrigante des Gaulois, l'indiscipline brutale des Francs. » Outre Pascal, qui à douze ans, seul et sans livres, inventait, à ses heures de récréation, les éléments de la géométrie dont il ignorait les termes; qui à seize ans composait son Traité des sections coniques, et épouvantait son père par la grandeur et la puissance de son génie, qui plus tard, dans les Provinciales et les Pensées, se montra le plus parfait peut-être des écrivains qu'ait produits la France. Outre ses grands jurisconsultes, l'Auvergne a fourni Gerbert (Sylvestre II ) le prodige et l'admiration de son siècle; de Belloy, l'auteur du Siège de Calais; le poète Danchet, Delille, le plus illustre poète de l'Empire, le fondateur ou du moins le plus éminent représentant de l'école descriptive ; Sirmont, le savant jésuite ; Chamfort, l'élégant et spirituel écrivain ; Thomas, qui, s'il déploya, dans le même genre, des qualités toutes différentes, dut à des qualités morales, qui ne furent point contestées, les plus beaux vers et les plus fiers qu'il ait composés ; de Barante, ce clair et rapide historien, qui entraîne si vivement au milieu des scènes animées qu'il déploie sous nos yeux, plus littérateur encore peut-être qu'historien, mais toujours admirable de mouvement et de couleur, et enfin Mr. Roulier, orateur et homme d'Étal sous le règne de Napoléon III.
.
Marche, Forez, Bourbonnais, Nivernais, Berry, Maine, Anjou, Orléanais
Nous réunirons toutes ces provinces en un seul chapitre, non pas qu'elles fournissent à la gloire de la France moins de noms que les autres provinces, mais en raison de leur situation géographique. Les autres, isolées sur les frontières, ne se touchant entre elles que par quelques points, ont dû à leur position des caractères particuliers qui ne permettaient pas de les réunir. Celles-ci, au contraire, placées au centre dans des conditions presque semblables, n'ont guère pour se distinguer les unes des autres que les influences affaiblies de ces provinces frontières qui les touchent à peine. Sans doute, le génie du Forez n'est pas celui du Bourbonnais sans doute, le sévère Orléanais ressemble au Nivernais, qu'il joint par un seul côté, plutôt qu'à la Touraine, cette molle et rieuse patrie de Rabelais, qui forme une grande partie de ses limites mais ces différences même réelles sont plutôt des nuances que des diversités, et cette étude, tout intéressante qu'elle serait, sortirait du cadre étroit de cet aperçu. Qu'il suffise de dire que nous trouverons ici, en général, la vivacité et l'imagination méridionale mitigée et modifiée par le caractère plus réfléchi et le génie plus profond du Nord ; qu'ici plus que partout ailleurs nous trouverons des différences et des contradictions, selon que chaque écrivain aura été plus exposé à l'une ou à l'autre de ces influences, toujours plus puissantes sur des esprits qu'un ensemble de qualités mieux balancées dispose à recevoir plus facilement les empreintes.
Les poètes y sont en grand nombre, et quelques-uns tiennent les premiers rangs dans notre histoire. Joachim du Bellay, qui lança le manifeste de la réforme de Ronsard, La défense et illustration de la Langue Françoise. Cet ouvrage est plein de verve et d'enthousiasme, et respire bien l'enivrement que fit alors éprouver aux intelligences délicates la découverte des trésors de l'antiquité. Malgré tout le mérite de ses poésies, cet ouvrage est son principal titre de gloire. Du Bellay s'y montre hardiment réformateur et ne veut rien moins qu'y substituer les formes antiques à la vieille littérature française. « Lis donc et relis premièrement, ô poète futur, disait-il, les exemplaires grecs et latins puis me laisse toutes ces vieilles poésies françoises aux Jeux floraux de Toulouse et au puy de Rouen, comme rondeaux, ballades, virelais, chants royaux, chansons et autres telles espiceries qui corrompent le goût de notre langue, et ne servent, sinon, à porter témoignage de notre ignorance. Jette-toi à ces plaisantes épigrammes, à l'imitation d'un Martial. Si la lascivité ne te plait, mêle le profitable avec le doux ; distille avec un style coulant et non scabreux de tendres élégies à l'exemple d'un Ovide, d'un Tibulle et d'un Properce. Chante-moi de ces odes inconnues encore de la langue françoise, d'un luth bien accordé au son de la lyre grecque et romaine, et qu'il n'y ait rien où n'apparoisse quelque vestige de rare et antique érudition. » Ronsard fut le premier à mettre en œuvre le programme de la réforme littéraire, rédigé par Joachim du Bellay. « D'abord, dit Mr. Demogeot, il essaya de créer d'un seul jet une langue poétique. Pour cela, il puisa sans ménagement aux sources grecques et latines. mais, avec toute son audace, Ronsard luttait contre l'impossible. Les langues ne se font pas en un jour. Ce sont des terrains d'alluvion créés par le temps, de hautes pyramides auxquelles chaque jour apporte sa pierre en passant. » Cependant, Ronsard n'est pas moins un génie plein d'enthousiasme, de poésie. A côté des mouvements du lyrisme le plus fier, on rencontre dans ses œuvres des morceaux d'une fraîcheur et d'une grâce charmante. Tout le monde sait quelle admiration il excita dans son siècle, et a appris par cœur les vers si nobles et si parfaits que lui adressa Charles IX. Baïf, un des disciples de Ronsard, né à Venise, appartient au Maine par son père ; il est connu par quelques vers, et par sa tentative hardie et infructueuse de soumettre la poésie française aux règles de la métrique ancienne. Remi Belleau était aussi disciple et ami de Ronsard, qui faisait grand cas de ses poésies. Avant eux, les auteurs du Roman de la Rose, Guillaume de Lorris, esprit délicat et doux, plus ingénieux que savant, plus naïf que hardi, et Jean de Meung, clerc libre-penseur, fort lettré et fort audacieux, qui entremêle ses longues dissertations, morales et immorales, d'invectives hardies contre les grands, les moines et le clergé ; doué d'une érudition immense, qu'il ne sut pas coordonner, mais qui créa le personnage de Faux semblant, un des ancêtres de Tartufe.
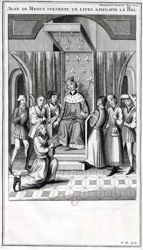
Desportes, disciple de Ronsard ; mais, instruit par son exemple, il sut se préserver de ses excès. Régnier, qui sut imiter les anciens sans les copier ; ses satires sont pleines de caractères très bien saisis ; mais son chef-d'œuvre est celui de Macette, la vieille hypocrite. On l'a comparé à Montaigne ; en effet, il a comme lui à un haut degré l'esprit, l'enjouement, la verve, et comme lui encore il s'est créé un style inimitable. Racan, le disciple de Malherbe, à qui il emprunta ses qualités sans ses défauts, et dont la douceur et l'élégance font pressentir le style de Racine, Rotrou, dont le génie fier et hardi rappelle parfois les mâles beautés de Corneille, surtout dans quelques scènes du Véritable Saint Genest et dans l'admirable tragédie de Vinceslas ; Adam Billaut, le Virgile du rabot, dont les poésies brillent par une verve et une originalité puissantes ; Papillon, auteur de poésies chrétiennes pleines d'imagination et de mouvement ; Grécourt, connu par ses poésies légères et très légères; Guimond de La Touche, l'auteur d’Epigénie en Tauride, qui eut un succès prodigieux et qui, sous le titre de Soupir du Cloitre où le triomphe du fanatisme, publia une satire violente des jésuites au milieu desquels il avait vécu ; Colardeau, le poète d'Héloïse et d’Abélard ; Desmahis, auteur de la comédie de l’Impertinent ; Destouches, qui s'est fait un nom par sa comédie du Glorieux ; l'aimable Panard, le gai chansonnier Collin d'Harleville, un de nos plus aimables écrivains comiques, qui parfois eut le tort de raconter ses personnages au lieu de les faire agir, mais dont la composition est, vivifiée par une chaleur cachée Dumersan, chansonnier et vaudevilliste ; Charles Loyson, que la mort enleva à vingt-neuf ans, et dont le talent promettait un écrivain distingué. Les prosateurs ne sont pas moins illustres que les poètes. Louis XI, qui n'était sombre qu'en politique, travailla aux recueils souvent licencieux du Rosier des guerres et des Cent Nouvelles nouvelles ; Billardon de Sauvigny, Dussaulx, le traducteur de Juvénal et l'auteur du Traité de la passion du jeu ; Gaillard, auteur dramatique ; Lavalette; le comte de Tressan, qui fit revivre en France les romans de chevalerie Bussy-Rabutin, le caustique et spirituel correspondant et rival de Mme de Sévigué, à qui son Histoire amoureuse des Gaules mérita le surnom de Pétrone français; le père Mersenne, l'ami et le correspondant de Descartes ; la savante Dacier; le grammairien Ménage ; Descartes, le père de la philosophie moderne, qui appartient par sa famille à la Bretagne, mais qui est né à La Haye, en Touraine les savants Desbillons, le père d'Orléans ; l'abbé Berthier ; Labbé, le collecteur des conciles; Jurieu, l'antagoniste de Bossuet et d'Arnaud ; l'abbé Guénée, le spirituel et mordant adversaire de Voltaire ; Nicole, une des gloires de Port-Royal; les orateurs Corbin, Chamillard ; Bourdaloue, l'éloquent raisonneur ; Mirabeau, qui, bien qu'enfant de la Provence, appartient à Nevers par sa naissance; et de nos jours Dupin aïné, aussi spirituel dans ses reparties qu'élégant dans ses discours judiciaires et politiques; le philosophe Destutt de Tracy, digne disciple de Coudillac, un des derniers et des plus éminents représentants de l'école sensualiste en' France; Fauriel, savant critique et historien; Volney, historien philosophe, qui a tant fait pour l'histoire de l'Orient, et qui par son style s'est assuré un rang élevé parmi nos écrivains; Brissot, l'homme politique et l'âme de la Gironde.. Mais avant tous et par la date et par le génie, nous devons placer Rabelais, ce prodigieux esprit, le Voltaire de son siècle, qui réunit en lui seul toutes les qualités du génie gaulois ; la verve, l'imagination poussée jusqu'au délire le bon sens élevé jusqu'à la plus haute éloquence. Sous cette enveloppe si gaie, parfois si burlesque, si obscène même, il se cache une pensée profonde. Il a vu tous les vices de son siècle ; il a prévu toutes les réformes, et, s'il n'a pas été brûlé, c'est que son siècle ne l'a pas compris et n'a vu de son livre que ses joyeusetés. Politique, religion, éducation, tout se trouve dans son livre, et plus d'une de ses idées a fait la fortune des écrivains qui plus tard les en ont tirées. Tour à tour cordelier, bénédictin, médecin, bibliothécaire, secrétaire d'ambassade et curé, « il y aurait trop à dire sur Rabelais. Il est notre Shakespeare dans le comique. De son temps, il a été un Arioste à la portée des races prosaïques de Brie, de Champagne, de Picardie, de Touraine et de Poitou. Nos noms de provinces, de bourgs, de monastères ; nos habitudes de couvent, de paroisse, d'université, nos mœurs d'écoliers, de juges, de marguilliers, de marchands, il a reproduit tout cela le plus souvent pour en rire. Il a compris et satisfait à la fois les penchants communs, le bon sens droit et les inclinations matoises du tiers état au XVIème siècle. Le livre de Rabelais est un grand festin, non pas de ces nobles et délicats festins de l'antiquité où circulaient, au son de la lyre, les coupes d'or couronnées de fleurs, les ingénieuses railleries et les propos philosophiques non pas de ces délicieux banquets de Xénophon ou de Platon, célébrés sous des portiques de marbre, dans les jardins de Scillote ou d'Athènes c'est une orgie enfumée, une ripaille bourgeoise, un réveillon de Noël. C'est encore, si l'on veut, une longue chanson après boire. » (Sainte-Beuve, Tableau de la poésie Française XVIème siècle.) Parmi les noms contemporains qui perpétuent les traditions des sciences ou de littérature dans ces provinces, nous citerons le baron Charles Dupin, Jules Janin, H. de Balzac, le profond observateur, qui malheureusement s'est surtout appliqué à représenter les laideurs de la nature humaine; Amédée Thierry, le savant historien de la Gaule; son illustre frère Augustin Thierry, le martyr de la science, qui a porté dans l'histoire l'intérêt du roman et les vives couleurs de la plus riche poésie, et a su mêler dans une juste mesure la critique historique aux dons les plus brillants de l'imagination enfin, George Sand, qui est comme l'antithèse de Balzac, et dont l'esprit noble et élevé, tout en frondant la société, s'est attaché avec amour aux qualités les plus généreuses du cœur humain. Les jurisconsultes sont nombreux dans ces provinces. Excepté Bodin et Duprat, les principaux appartiennent surtout au Nivernais et à l'Orléanais. Gui Coquille, les Lamoignon, Marchaugy, Dupin aîné sont de Nevers; de l'Orléanais, Pothier, Isambert et Pardessus.
Ile de France et Picardie

Nous voici arrivés maintenant au véritable centre politique et intellectuel de la France, Paris et les provinces qui l'environnent. C'est là que, pendant longtemps, fut concentrée toute notre histoire ; c'est là qu'aboutissent et se fondent toutes les forces vives de la France pour former un esprit général, l'esprit de la nation c'est là le cœur du pays, qui reçoit et renvoie aux provinces le sang transformé ; l'aliment de la vie ; chacun de ses mouvements se fait sentir jusqu'aux extrémités. On pourrait dire de Paris ce que Balzac disait de Rome « C'est la boutique où s'achèvent les dons naturels. » Cette contrée, si riche par elle-même, est plus riche encore par le tribut des provinces, qui lui envoient pour les former l'élite de leurs enfants. Ici est le rendez-vous de tous les grands esprits ; ici s'opère la fusion des races, des idées, des caractère. C'est du mélange de toutes ces individualités que s'est formé le caractère général de notre esprit et de notre littérature. Là nous retrouvons à la fois et la verve intarissable du Midi avec, le mysticisme et le sensualisme du Nord, l'esprit critique de l'Est uni à la ténacité des provinces occidentales ; le tout mêlé à la finesse ironique de la Champagne, à l'éloquence et à la poésie inspirée de la Bourgogne. « Pour faire connaître le génie de ces écrivains, dit l'historien que nous avons déjà cité, il n'est qu'une manière, c'est de raconter l'histoire de la monarchie ; on les caractériserait mal en citant quelques noms propres, ils ont donné l'esprit national. Ils ne sont pas un pays, mais le résumé du pays. Les écrivains si nombreux qui sont nés à Paris et dans l'Ile-de-France doivent beaucoup aux provinces dont leurs parents sont sortis ; ils appartiennent surtout à l'esprit universel de la France qui rayonna en eux. En Villon, en Boileau, en Molière et Regnard, on sent tout ce qu'il y a de plus général dans l'esprit français ; ou, si l'on veut y chercher quelque chose de local, on y distinguera tout au plus un reste de cette vieille sève d'esprit bourgeois, esprit moyen, moins étendu que judicieux, critique et moqueur, qui se forma d'abord de bonne humeur gauloise et d'amertume parlementaire. Mais ce caractère indigène et particulier est encore secondaire, le général y domine. » Aussi l'unique difficulté est-elle ici de choisir parmi cette infinité de noms illustres. Sans doute il en est quelques-uns qui s'imposent, mais que chacun nomme tout d'abord, et l'on ne peut hésiter à citer des écrivains comme Molière, Racine, Regnard, Boileau, Béranger, Calvin, Mme de Sévigné, Voltaire, Mme de Staël et quelques autres ; c'est quand on arrive au second rang qu'il devient difficile de choisir parmi tant d'hommes qui se recommandent à des titres si différents. Aux premiers siècles de notre littérature, ces provinces de l'Ile-de-France produisirent Blondel, célèbre par son attachement à Richard Cœur de Lion, et Rutebeuf, sur lequel nous nous arrêterons quelque temps, comme représe ntant mieux qu'aucun autre l'immense famille des trouvères.
Voici le portrait qu'en fait M. Demogeot dans ce style si vif et si net qui distingue son ouvrage « L'un des plus hardis et des plus habiles trouvères est Rutebeuf, contemporain de saint Louis. Vilain d'origine, clerc par le savoir, laïque par l'habit, quand il en avait un, pauvre existence vagabonde pour qui la société n'avait pas encore de place c'est au roi, c'est aux seigneurs qu'il demande le pain de chaque jour ; mais le roi, mais les grands ont bien autre chose en tête que le pauvre Rutebeuf, et, s'il vit de leur générosité, il est exposé à mourir de leur oubli. Le pire est qu'il ne mourra pas seul ; le pauvre poète a eu le tort de croire encore qu'il était homme, et a fait l'imprudence d'avoir une femme, des enfants. Au milieu de sa détresse, sa verve ne l'abandonne pas il trouve des traits sanglants contre les prélats, les papelards et les béguins. Il sait que le roi les protège ; n'importe, il aime mieux perdre la protection du roi qu'une malice. » Charles d'Orléans est, avec Thibaut de Champagne, le plus parfait et le plus gracieux de nos trouvères. Il possède à un haut degré le sentiment du rythme et de l'harmonie poétique.

Pour la première fois, la poésie française atteint la beauté de la forme et produit une œuvre d'art mais, s'il y a dans cette poésie beaucoup de grâce, il y a peu d'inspiration et point de pensée. Toutes les misères de la France et ses propres malheurs n'ont pas arraché un cri à Charles d'Orléans. Pour lui, la poésie est un jeu d'esprit, charmant souvent mais l'émotion n'est jamais qu'à la surface. « Villon, écolier de l'Université de Paris, vrai basochien, espiègle, tapageur, libertin et, qui pis est, larron; passant sa vie entre le cabaret, la prison, la faim et la potence; toujours pauvre, toujours gai, toujours railleur et spirituel; mêlant aux saillies de sa joyeuse humeur des traits nombreux d'une sensibilité rêveuse et quelquefois élégante». (Demogeot), est le premier en date des poètes modernes. Ceux qui l'ont précédé sont des trouvères, même Charles d'Orléans. Il chante sa vie, ses misères, ses émotions ; il décrit le monde où il vit. Là, rien de convenu ni d'allégorique, Mélancolique et gai à la fois, il est toujours lui-même, et plus d'une de ses pièces de vers, telles que celles du Grand testament et des neiges d'antan, sont restées dans les mémoires. Condamné à être pendu, pour vol (« nécessité, dit son premier biographe, fait gens méprendre et faim saillir le loup du bois), » il obtint sa grâce du roi Louis XI et se retira en Poitou, à Saint Maixent, où il mourut. Après lui, Jodelle, Hardy fondèrent en France le théâtre sur l'imitation de l'antiquité ; et leurs tragédies marquent un progrès très sensible sur les mystères des confrères de la Passion, qu'un arrêt de 1548 avait dépossédés de l'hôtel de Bourgogne pour le céder à une compagnie de comédiens sous la direction de Hardy. Ce sont les ancêtres de la tragédie et de la comédie en France. Mais ces deux genres n'atteignirent leur perfection qu'avec Corneille, Racine et Molière. Ces deux derniers appartiennent à l'IIe-de-France. Il y aurait trop à dire sur ces deux noms pour que nous nous y arrêtions. Qui n'a pas lu ces scènes immortelles qui font passer sous nos yeux l'humanité tout entière, tantôt avec son héroïsme, ses côtés élevés et tendres, ses passions violentes, comme dans Racine ; tantôt, dans la comédie de Molière, avec tous ses travers et ses ridicules ? On les sait par cœur, et l'admiration de chacun suppléera facilement à notre silence.
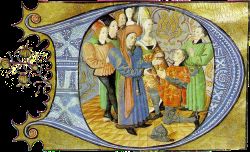
Autour de chacun de ces deux noms se rangent
une cohorte d'imitateurs plus ou moins heureux. Derrière Molière, nous
trouvons Regnard, Montfleury, Baron, Dufresny, Gresset, Sedaine, Marivaux,
Favart, et bien d'autres encore, qui tous, volontairement ou non, ont
subi l'influence du grand comique et marchent de plus ou moins loin
sur ses traces. Les successeurs de Racine ne sont pas moins nombreux.
Ce sont tous les tragiques qui ont écrit après lui. Quelques-uns seulement
appartiennent à l'Ile-de-France. Ce sont Lafosse, Lemierre, La Harpe,
tous bien inférieurs à leur modèle. Quinault même, sans être un imitateur
de Racine, lui ressemble aussi par quelques côtés. Ducis, plus vraiment
poète peut-être qu'aucun de ces tragiques de second ordre, a transporté
sur la scène française, en les affaiblissant , quelques-uns des chefs-d’œuvre
de Shakespeare. Le XIXème siècle a aussi ses poètes dramatiques
Népomucène Lemercier, qui a introduit dans l'art quelques éléments nouveaux
; et de nos jours, les deux Dumas, père et fils, qui ont illustré la
scène moderne, l'un par ses drames pleins de vie, de mouvement et de
passion, et l'autre par ses comédies de mœurs et de caractères, où l'esprit
et l'observation font rarement défaut.
Boileau aussi, le grand critique
du XVIIème siècle, a eu de nombreux imitateurs, dont il serait
trop long de citer les noms. L'école moderne a eu son satirique, le
poète Barbier, dont les ïambes respirent souvent une violence pleine
d'énergie, notamment dans la Curée qui a eu un si grand retentissement.
A l'Ile-de-France appartient, par son esprit comme par sa naissance
; Béranger le poète populaire qui, laissant en arrière les Collé, les
Panard et les Désaugiers, éleva la chanson à la hauteur de l'ode. Sa
muse véritablement démocratique, dit Mr. Demogeot, ennoblit le peuple
en s'exprimant ; elle lui parla une langue digne de ses destinées futures,
et lui reconnut, comme prélude ou comme complément de ses autres droits,
son droit à la poésie. Plusieurs des chansons patriotiques de notre
poète, un grand nombre de ses chansons morales sont de véritables odes.
L'antiquité n'a rien de plus beau que Mon Ame, le Dieu des bonne
Gens Le Cinq Mai, La Bonne Vieille, Mon Habit égalent en grâce touchante
certaines odes célèbres d'Horace et aucune littérature n'a rien de comparable
à cette foule de malins couplets politiques, dont on peut apprécier
diversement la tendance, mais non l'imperfection. Cet élan lyrique,
cette délicatesse de sentiment, cette verve d'esprit, Béranger a su
les rendre populaires, et les graver dans la mémoire des artisans de
nos villes, de manière à pouvoir, seul de tous nos poètes, se passer
au besoin, du secours de la presse.
La poésie légère et tous les
genres inférieurs ont été cultivés par des écrivains nombreux. Chapelle,
Collé, Mme Deshoulières, Bachaumont, Scarron, Dorat, Laujon, etc., ont
tous des mérites différents ; et si nous faisions autre chose qu'une
statistique littéraire, ils nous fourniraient des sujets d'étude intéressants.
Les prosateurs sont plus nombreux encore. Calvin,
le propagateur de la Réforme en France, et dont les écrits sont par
leur netteté et leur vigueur de style un des premiers monuments de notre
littérature. C'est au roi François Ier qu'il dédia son Institution
de la Religion Chrétienne « l'œuvre la plus importante qu'eût produite
encore la Réforme. » Calvin n'avait alors que vingt-six ans. Amyot porta
dans la traduction l'originalité la plus marquée, au point de faire
illusion à la postérité sur le vrai caractère des écrivains qu'il a
traduits. « Il a en quelque sorte créé Plutarque, il nous l'a donné
plus vrai, plus complet que ne l'avait fait la nature. »
Viennent
ensuite les écrivains qui comblent l'intervalle jusqu'au XVIIème
siècle Budé, Charon, le disciple de Montaigne et souvent son copiste
; Pasquier, Rollin, ainsi caractérisé par Montesquieu Un honnête homme
qui, par ses ouvrages, a enchanté le public. « C'est, dit-il, le cœur
qui parle au cœur ; on sent une secrète satisfaction d'entendre parler
de la vertu. C'est l'abeille de la France. » Citons en passant les travaux
historiques ; de l'abbé Fleury et du président Hénault ; les plaidoyers
éloquents de Jean Boucher, des Cuchin, des Patru, et les savantes publications
de Robert et de Henri Estienne. Les grammairiens, les critiques, tels
que Gui Patin, Restaut, l'abbé d'Aubignac, Bouhours, Furetières, Lancelot;
les historiens de second ordre, Du Cange, Gaillard, Charlevoix, l'abbé
Dubos, Quesnay, Bailly, Ruthières, Letronne, le président de Thou, Crevier,
Lebeau, de Tillemont, malgré leur science et leurs immenses recherches,
sont cependant, par la nature même de leurs ouvrages et de leur génie,
en dehors de la littérature proprement dite.

Ramus, moins littéraire encore, mérite cependant
d'être distingué par ses persévérants et courageux efforts pour rendre
l'indépendance à la philosophie et l'arracher à l'influence exclusive
d'Aristote. Il est à remarquer que les grands écrivains de l'Ile-de-France
et surtout de Paris datent presque tous du XVIIèmee siècle.
Jusque-là, en effet, les provinces non encore fortement reliées au centre
vivaient de leur vie propre ; mais, depuis le XVIIème, Paris
est devenu vraiment le centre intellectuel de la France c'est alors
que, par la centralisation puissante de Louis XIV, cette ville est devenue
comme le résumé de l'esprit général du pays. Aussi au XVIIème
siècle, outre les grands poètes que nous avons déjà cités, nous trouvons
une foule d'éminents écrivains. Racine, Molière, si grands par leurs
poésies, ne le sont pas moins par leurs ouvrages en prose, Molière surtout.
Un grand nombre de ses pièces sont écrites en prose, et l'on sait que
Fénelon préférait sa prose à ses vers. Malebranche, disciple de Descartes,
qui exagéra ses tendances spiritualistes, est aussi remarquable par
la netteté et l'éclat de son style que par la singulière subtilité de
sa pensée. Voiture, l'homme de l'hôtel Rambouillet, sans être un écrivain
éminent, déploya cependant dans ses lettres des qualités d'esprit très
remarquables. Trop admiré par son siècle, par Boileau même, qui le place
à côté d'Horace, il a peut-être été trop abaissé depuis. Si l'on sent
la recherche et l'effort dans ses écrits, quelquefois aussi on y trouve
un esprit naturel et de bon aloi parfois même un bon sens sérieux vient
se mêler à son enjouement.
Dans le même genre, mais dans un rang
infiniment supérieur, brille Mme de Sévigné. Dans ses lettres, merveilleuses
de naturel, d'abandon et parfois d'éloquence, nous retrouvons tout l'esprit
de cette société du XVIIème siècle, qui en eut tant, mais
sans apprêt, sans désir d'être admirée, d'autant plus admirable par
là même. « Sa correspondance, comme un miroir enchanté, nous fait connaître
la cour et ses intrigues, le roi et ses maîtresses, l'Église, le théâtre,
la littérature, la guerre, les fêtes, les repas, les toilettes. Tout
cela s'anime et se colore en traversant l'esprit de cette femme charmante.
» « Je n'ai jamais eu l'imagination aussi frappée, disait le duc de
Villars-Brancas après avoir achevé la lecture de ses lettres ; il m'a
semblé que d'un coup de baguette, comme par magie, elle avait fait sortir
cet ancien monde pour le faire passer en revue devant moi. » Les Mémoires
du duc de Saint-Simon, restés secrets jusqu'à nos jours, sont encore
un tableau de cette époque, mais à un autre point de vue. Cet écrivain
incorrect, mais d'une énergie d'expression, d’une verve incomparable,
nous dépeint la cour du grand roi avec toutes ses intrigues, ses petitesses
; il fait passer sous nos yeux tous les personnages qui la composent,
et les marque en passant d'un trait ineffaçable. Remontant ensuite au
règne de Louis XIII, il descend au régent et au cardinal Dubois ; mais
quelle variété et quelle vie dans ses portraits. Passionné, mais en
même temps profond et juste appréciateur, il rend justice à chacun,
et ses préventions ne le trompent jamais entièrement sur un caractère.
Au-dessous d'eux, citons Scarron, le poète burlesque, mais qui eut la
gloire par son Roman Comique de discréditer les subtilités puériles
qui étaient jusqu'alors le caractère de ce genre; le grand Arnauld,
ce violent et puissant janséniste, qui dépensa un immense talent à composer
des ouvrages de polémique, aujourd'hui tombés dans l'oubli comme le
sujet qui leur donna naissance; les de Sacy, dont les ouvrages et le
style rappellent les qualités sévères de l'école de Port-Royal ; La
Motte-Houdard, très paradoxal et très modéré, à demi révolté contre
la routine, mais le plus pacifique et le plus poli des révoltés, plein
de sens et de goût dans la défense même des idées littéraires les plus
contestables, moins heureux dans l'application que dans la théorie,
et démolissant souvent sa critique par ses ouvrages. Cet écrivain nous
amène au XVIIIème siècle, à Beaumarchais, d'Alembert, Condorcet,
Voltaire.

D'Alembert, géomètre illustre, savant de premier
ordre, s'est créé un rang dans la littérature par un style exact, élégant
et fin. C'est lui qui écrivit le Discours qui sert d'introduction à
l'Encycopédie, et ce titre seul suffirait pour lui mériter notre admiration.
C'est un magnifique exposé des progrès des sciences et des lettres depuis
le XVIIème siècle. Comme d'Alembert, Condorcet unit la gloire
du savant à celle de l'écrivain et du philosophe ; il fut le biographe
et l'un des plus fervents admirateurs de Voltaire. Celui-ci, poète épique
et dramatique de second ordre, mais sans rival dans la poésie légère,
et le premier peut-être des prosateurs français par la clarté, la netteté,
a rempli tout son siècle de sa gloire. Cette rare intelligence avait
pour qualités dominantes la passion et le bon sens ; et le produit de
ces deux forces fut un esprit étincelant, universel, irrésistible, le
génie de l'esprit. Beaumarchais rappelle Voltaire par sa verve ironique
et mordante, son bon sens, son esprit, sa plaisanterie active, inépuisable,
pleine d'audace et souvent d'éloquence. C'est lui qui, par ses mémoires
contre le sieur Goesman, acheva la ruine du parlement Maupeou, et qui,
dans ses comédies, dont le défaut est d'être trop spirituelles, créa
ce Figaro, ce spirituel, cet industrieux barbier, et à qui il a fallu
déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement qu'on
n'en a mis depuis cent ans à gouverner les Espagnes ; qui sait la chimie,
la pharmacie, la chirurgie, broche des pièces de théâtre, rédige des
journaux, écrit sur la nature des richesses, et risque fort de mourir
à l'hôpital ; ce descendant de Panurge, ce représentant de la roture
enfin qui bientôt va succéder par son habileté à ces gens qui ne
se sont donné d’autre peine que de naitre.
Camille Desmoulins,
autre successeur de Voltaire, mit son esprit tout athénien au service
des idées les plus violentes, mais eut pour excuse une conviction profonde.
Doué d'une imagination pleine de grâce et souvent de vigueur, il eut
le rare privilège d'écrire des ouvrages de circonstance qui se lisent
encore aujourd'hui.
C'est à la même époque que commencèrent à se
faire connaître deux femmes que leur génie met à part de leur sexe.
Nous avons trouvé bien des noms de femmes dans l'histoire de notre littérature,
mais aucune ne peut être comparée pour la vigueur et l'élévation de
la pensée à Mesdames Roland et de Staël. Mais il y a cette différence
entre elles que l'une, entièrement mêlée à la politique, y resta constamment
enfermée. Douée des sentiments les plus mâles, elle ne respira que liberté
et fut l'âme de la Gironde. L'autre, génie plus vaste et plus complet,
douée de tous les talents, accessible à toutes les idées vraies, à toutes
les émotions généreuses, parcourant toutes les régions de la pensée,
depuis les considérations les plus profondes de la philosophie et de
la politique jusqu'aux fictions les plus brillantes de l'imagination,
réunit sans confusion les éléments et les qualités les plus divers.
Mme de Staël appartient plutôt au XIXème siècle qu'au XVIIIème
et nous ramène aux temps contemporains.

Nous en citerons seulement quelques noms. Picard,
le plus fécond et le meilleur auteur comique de l'école impériale, fut
le peintre de la vie ordinaire, et réussissait mieux à saisir les ridicules
fugitifs des contemporains que les défauts et les folies héréditaires
de l'homme mais là il est d'une verve et d'une gaieté intarissables.
« Chacune de ses comédies est le développement d'une maxime de morale
pratique ou de prudence vulgaire. Ses pièces sont des apologues dramatiques
c'est Ésope sur le théâtre. » Paul-Louis Courier fut un admirable artisan
de langage ; mais, « habitué par son éducation à saisir rarement le
grand côté des choses, il ne vit dans l'Empire que des prétentions ridicules,
et dans la Restauration qu'un objet de mesquines tracasseries. C'est
le libéralisme dans ce qu'il y a de plus étroit et de plus bourgeois.
Mais il est difficile d'avoir plus d'esprit sur un sujet donné, plus
de malice sous une apparente bonhomie que Paul Louis n'en jette à pleines
mains dans ses feuilles légères, dans son Livret, dans sa Gazette du
village, dans son Pamphlets des pamphlets. » (Demogeot.) Villemain a
laissé des souvenirs ineffaçables dans l'esprit de ceux qui ont entendu
ses leçons à la Sorbonne. Voici le jugement qu'a porté sur lui l'illustre
Goethe « Villemain s'est placé très haut dans la critique. Les Français
ne verront sans doute jamais aucun talent qui soit de la taille de celui
de Voltaire ; mais on peut dire de Villemain qu'il est supérieur à Voltaire
par son point de vue, en sorte qu'il peut le juger dans ses qualités
et dans ses défauts. »
Un autre enfant de Paris, Cousin, à la
même époque, popularisait en France les plus hautes doctrines philosophiques
de l'Allemagne, et par là exerça une grande influence sur la plupart
des esprits sérieux, non pas seulement en philosophie. Son premier ouvrage
Sur le fondement des idées absolues du vrai, du beau et du bien renfermait
un enseignement littéraire plus puissant et plus fécond que tous les
livres écrits pendant le siècle précédent sur la littérature. Il a posé
la base de l'esthétique, et les écrits purement littéraires qu'il a
publiés depuis ont montré que, si nul n'était plus digne de découvrir
et de dévoiler les sources philosophiques du beau, personne n'était
aussi plus capable d'en appliquer les principes dans les œuvres d'art.
Telle est la part de chaque province de la France dans son histoire littéraire. Parmi les auteurs contemporains, nous nous bornerons, pour terminer cette esquisse générale de notre histoire littéraire, à citer les plus connus, en attendant que la postérité ait prononcé en philosophie Renan, l'auteur de la Vie de Jésus; Jules Simon, Vacherot, l'auteur de l'Histoire critique de l'École d'Alexandrie ; Auguste Comte, le chef de l'école positiviste; AD. Franck; en histoire Mignet, Louis Blanc, Victor Duruy, Henri Martin, Lanfrey, d'Haussonville, Camille Rousset, Ternaux, Achille de Vaulabelle ; en géographie, après les Gosselin, les d'Anville, qui avaient illustré le siècle dernier Conrad Malte-Brun, Danois d'origine, mais Français et Parisien par ses écrits ; Jomard, Vivien de Saint-Martin, d'Avezac, Ernest Desjardins, Élisée Reclus, E. Levasseur, Ad. Joanne, E. Cortambert ; en philologie J.-J. Ampère, Littré, Ch. Magnin, Désiré Nisard, Taine; en poésie Victor Hugo, François Coppée, Jean Richepin, Joseph Autran, Sully Prudhomme, Victor de Laprade, Leconte de Lisle, Théodore de Banville ; en littérature dramatique Victorien Sardou, Alexandre Dumas fils Octave Feuillet, Camille Doucet, Henri Bornier; dans le roman Gustave Flaubert, Zola, Jules Charetie, Ernest Feydeau, Erckmann-Chatrian, Alphonse Karr, Jules Sandeau, Jules Verne, les frères de Goncourt, etc.
Conclusion
Pour conclure cet excellent article, nous devons à tous les écrivains, non seulement le savoir et la connaissance, mais également le plus beau de notre héritage linguistique c’est dire, le Français tel que on le parle aujourd’hui.
![]()
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025